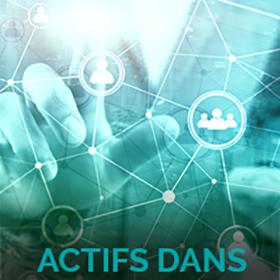Thématique
Biodiversité
Si l’impact des activités humaines, dont l’agriculture, sur la biodiversité n’est plus à démontrer, leur évolution vers des systèmes plus durables peut être source de solutions pour préserver ce bien commun.
Nos travaux s’intéressent aux espèces, à leurs gènes, ainsi qu’aux écosystèmes qui les accueillent et les nourrissent. Ils étudient les flux et les interactions entre les multiples écosystèmes terrestres et aquatiques et les acteurs, aux échelles des paysages, des bassins versants ou des territoires. Nos approches recourent à l’agroécologie pour une meilleure utilisation des régulations naturelles et aux solutions fondées sur la nature pour restaurer la biodiversité, tout en faisant face aux risques. Nous travaillons à la valorisation des richesses naturelles des écosystèmes et des services qu’ils rendent, notamment au travers de la bioéconomie.

Connaitre, préserver, restaurer la biodiversité
Du gène à l’écosystème, en passant par l’espèce, nos recherches s’intéressent à toutes les dimensions de la biodiversité. Elles portent sur leur dynamique et leur gestion ; l’analyse de leurs valeurs et leurs fonctions à différentes échelles. Elles explorent également la connaissance des sols et des liens avec le cycle de l’eau et les autres cycles biogéochimiques (carbone, azote…) ; les impacts des pressions multiples et les risques associés ainsi que le fonctionnement et les services rendus par les écosystèmes. Elles intègrent la diversité des perceptions et des représentations entre acteurs dans les territoires.
La conservation des ressources génétiques, le rôle de la biodiversité dans la résilience et la durabilité des systèmes, les dynamiques paysagères et cycles des éléments et la gestion adaptative des écosystèmes sont au cœur des perspectives de nos recherches. Observation, expérimentation et modélisation à différentes échelles spatiales et temporelles sont ainsi mobilisées tandis que se combinent des approches socioéconomiques et biotechniques.
Des résultats marquants
Notre actualité
Focus sur
Biodiversité et durabilité des agricultures

Nombreux sont les travaux scientifiques qui tirent la sonnette d’alarme à propos du déclin de la biodiversité. Parce qu’un tiers de la surface terrestre est dévolu à des usages agricoles, l’articulation de l’agriculture et de la biodiversité demeure une préoccupation majeure.
Le colloque du 11 avril 2019 a permis d’explorer la prise en compte de la biodiversité par le secteur de l’agriculture et d’illustrer les avancées réalisées tout autant que le chemin qu’il reste à parcourir.
Nos dossiers
INRAE 2030
Répondre aux enjeux environnementaux et gérer les risques associés

Répondre aux enjeux environnementaux et gérer les risques associés est l'orientation scientifique n° 1 du projet INRAE 2030. Nos objectifs sont :
- Biodiversité : comment la préserver ? Comment mieux s’appuyer sur les services fondés sur la nature ?
- Comprendre et mobiliser l’adaptation du vivant pour les transitions alimentaires, agroécologiques, et pour la préservation de la biodiversité
- Évaluer et gérer les risques naturels et climatiques.