Dossier revue
Société et territoiresRéussir son installation dans un contexte de transitions
Publié le 06 mars 2025

Transmission familiale ou autre, la réussite d’un projet d’installation dépend pour beaucoup des moyens financiers et fonciers du futur agriculteur.

S’installer
Quatre principaux types d’instruments, proposés au niveau européen et national, sont mis en œuvre par l’État, les Régions et différents partenaires pour faciliter l’installation, dont celle des jeunes agriculteurs, et la transmission des exploitations : aides directes ou soutiens à l’investissement, aides fiscales et exonérations sociales et enfin encadrement du marché foncier agricole par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). À quoi s’ajoutent des actions d’information et d’accompagnement essentiellement portées par le programme d’accompagnement à l’installation et à la transmission financé par l’État et les Régions. La délivrance d’autorisations d’exploiter vise à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Les schémas directeurs des exploitations agricoles accordent, dans certaines régions, une priorité plus élevée aux candidats dont le projet s’inscrit dans une démarche environnementale.
- 12 544 agriculteurs sensibilisés par les chambres d’agriculture aux enjeux de la transmission en 2023
- 1 520 premières installations accompagnées par les Safer en 2022
- 2/3 des porteurs de projets se sont installés, sur les 19 250 reçus aux points d’accueil installation, entre 2019 et 2022
- 38 % d’entre eux ont bénéficié de la politique de soutien à l’installation
L’enjeu de la transmission
Le volet transmission reste toutefois un chantier à davantage investir, aussi bien par les exploitants, afin de garantir une meilleure transmissibilité de leur exploitation, que par les pouvoirs publics, afin de mieux adapter les politiques publiques. Pour cela, différents éléments gagneraient à être mieux pris en considération : prix des exploitations complexes à fixer, marché peu transparent, inadéquation entre exploitations à céder et souhaits des nouveaux agriculteurs, concurrence entre installation et agrandissement…
La valeur d’une exploitation agricole dépasse la seule cession des facteurs de production (foncier, bâtiments, cheptel, matériel…). Les travaux réalisés dans le cadre du projet Farm_Value (2017-2021), coordonné par INRAE, mettent en évidence l’importance de facteurs immatériels qui peuvent être difficiles à quantifier. Par exemple, plus le cédant apprécie positivement les compétences du repreneur à pérenniser l’exploitation, plus il est prêt à faire des arrangements qui diminuent le prix de la reprise. Par ailleurs, une exploitation convertie à l’AB ou incluse dans une zone d’appellation sera davantage valorisée.
La présence d’un successeur valorise l’exploitation. « Pour les agriculteurs, transmettre son exploitation est une étape d’une importance majeure dans leur vie. Elle est la mesure de la réussite d’une vie de travail, et engage la perpétuation de ce qui a été construit », commentent Laure Latruffe, économiste INRAE et coordinatrice du projet Farm_Value, et Philippe Jeanneaux, enseignant-chercheur en économie rurale (VetAgro Sup).
Moderniser les aides publiques
En 2023, un rapport de la Cour des comptes constatait que les instruments d’aide à l’installation et au démarrage sont insuffisamment adaptés à la diversité des modèles d’exploitations et des profils. Ils sont devenus peu à peu inopérants et peinent à soutenir des projets singuliers, par exemple en circuits courts. Autre exemple, le système d’aide à l’installation bénéficie essentiellement aux moins de 40 ans, alors qu’un tiers des installations est le fait de personnes plus âgées. Enfin, les contraintes administratives sont perçues comme des freins et les instruments d’aides à l’installation sont globalement peu mobilisés.
Les dispositifs d’aide à l’installation agricole donnent toutefois accès à des formes de coopération appréciées des repreneurs. Celles-ci permettent une meilleure prise en main de l’exploitation et limitent la baisse de performance qui survient généralement dans les 3 à 5 ans suivant l’installation.
- Les espaces-tests agricoles chez un agriculteur permettent à un candidat à l’installation d’éprouver son projet. Plus de 1 500 personnes sont passées par ce dispositif depuis 2007, date de sa création, et plus de 81 % des projets testés concernent une production agricole certifiée AB.
- Les stages de parrainage donnent au candidat qui s’installe en dehors du cadre familial une formation pratique sur la conduite de l’exploitation à reprendre ou dans laquelle s’associer.
- Le droit à l’essai assure une année de transition sur un GAEC et permet au candidat de se retirer si le projet ne lui convient pas.
À l’actif des Safer et de leurs partenaires, le fonds de portage capitalistique Elan au service du renouvellement des générations en agriculture et des transitions permet à de jeunes agriculteurs de s’installer sans investir tout de suite dans le foncier, mais avec la possibilité de le faire par la suite.
Des initiatives plurielles
Depuis quelques années, des acteurs publics locaux (communes, intercommunalités ou syndicats mixtes), des structures nationales de développement agricole et rural (têtes de réseaux, coopératives ou fédérations…) et des structures d’accompagnement, de formation ou de financement agricole (Eloi, Fermes en vie, Cowgestion, Terrafine, Ceinture verte, Neofarm, Cultures et compagnies…) mettent à disposition des propriétés foncières, souvent en faveur de néo-agriculteurs engagés dans des pratiques durables. Néanmoins, leur caractère local et leurs moyens humains et techniques limités font que ces actions restent marginales (Fermes en vie évoque 18 fermes déjà financées et 1 300 ha convertis en agroécologie depuis 2020, Ceinture verte mentionne une quinzaine de maraîchers installés à ce jour). Autre exemple, les stages « Paysan créatif » sont proposés par des coopératives d’installation en agriculture paysanne (CIAP) en Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne. La CIAP Centre-Val de Loire propose, en complément, un portage temporaire d’activité qui permet de lancer son activité sans créer d’entreprise, de déléguer l’administratif à la CIAP et d’être accompagné dans son démarrage jusqu’à 3 ans.
D’autres initiatives voient le jour. En 2023, le groupe coopératif Terrena, implanté dans le Grand Ouest de la France, a mobilisé 48 millions d’euros sur 5 ans afin de consolider ou aider à la transmission des exploitations, tous types d’agriculture, tous modèles d’exploitations et tous modes de productions confondus.
LE COLLECTIF, UNE VOIE D'AVENIR
Les échanges entre pairs constituent un point d’appui intéressant quand l’exploitant fait face à la transmission (regard extérieur, soutien psychologique, lien au territoire…) ou s’engage dans la transition agroécologique (diffusion de ressources, gestion de l’incertitude…).
Mais cela n’est pas si simple ! Il s’agit, pour les personnes qui accompagnent, de réunir des collectifs pertinents, d’être en capacité de mobiliser des agriculteurs qui seraient éloignés de cette démarche et de la faire vivre ¹. Les collectifs agroécologiques que sont les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), les groupes 30 000 et les fermes DEPHY, sont destinés à faciliter l’échange de leurs pratiques agricoles, ainsi que le partage de leurs expériences et connaissances en agroécologie. Environ 32 000 agriculteurs y sont engagés (depuis 2010 pour les groupes DEPHY Fermes, 2014 pour les GIEE et 2016 pour les groupes 30 000).
1. Cnudde C. et al. (2023) Explorer la voie du collectif pour relever le défi de la transmission en agriculture. Étude d’un groupe d’agriculteurs du Maine-et-Loire. 17es Journées de recherches en sciences sociales, Paris-Saclay, 14 et 15 décembre 2023.
Slimi C. et al. (2022). Revue d’anthropologie des connaissances, 16 (2).

Pour aider les collectivités et les citoyens à agir en faveur de la préservation des terres agricoles, Terre de Liens et INRAE lancent la plateforme RÉCOLTE - Recueil d’initiatives foncières. En proposant des expériences innovantes de gestion du foncier agricole, ce site web contribue à la sauvegarde des terres et à l'installation d'agriculteurs.
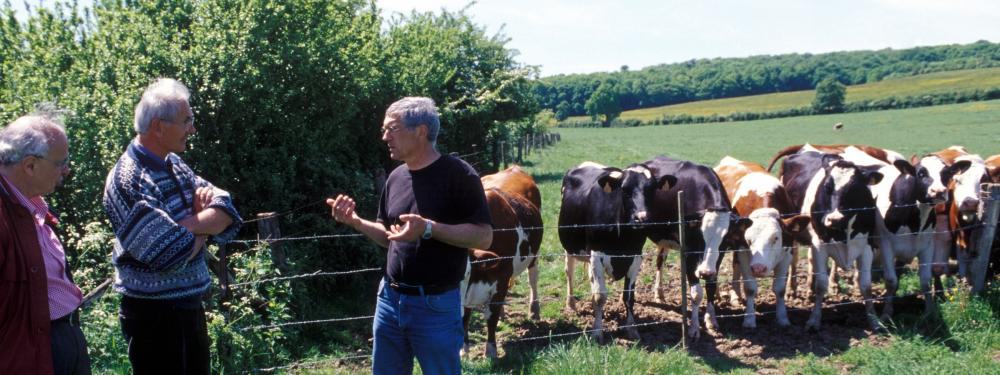
Mobiliser les capitaux et le foncier
Le coût de la reprise est régulièrement présenté comme une barrière à l’entrée pour de nouveaux agriculteurs ou comme un facteur à l’origine de difficultés financières des exploitations au cours des premières années d’installation. Cependant, peu de données sont disponibles. L’étude des dossiers de demande de dotation jeune agriculteur (DJA) déposés dans le Puy-de-Dôme (63) par 1 251 agriculteurs de moins de 40 ans entre 2007 et 2022 a montré que le coût moyen de reprise est de 79 457 € et le coût moyen des investissements au cours des 4 années suivantes est de 201 997 €, soit l’essentiel (70 %) du coût total d’installation. Celui-ci présente cependant une très forte hétérogénéité, reflet de la diversité des formes d’installation et des profils des installés1. L’emprunt est déterminant pour financer toutes les phases de l’installation, à hauteur de 80 % pour la phase de reprise et de 65 % pour la phase d’investissement. La DJA attribuée contre un certain nombre d’engagements est très hétérogène. Définis et modulés selon différentes caractéristiques du jeune agriculteur, de son projet et de sa localisation dans le territoire, les montants attribués sont sans relation directe avec le montant des investissements réalisés. La DJA n’est ainsi pas un levier essentiel de financement des actifs à acquérir, mais plutôt une réserve de financement susceptible de pallier des situations que le jeune agriculteur rencontre lors de l’installation (absence de revenu, besoin de trésorerie, besoin d’autofinancement…).
1 Jeanneaux P. et Latruffe L. Coûts et financement de l’installation aidée entre 2007 et 2022 : éclairages à partir du cas du Puy-de-Dôme. 17es Journées de recherches en sciences sociales, Paris-Saclay, 14 et 15 décembre 2023
- 85 % de la SAU française (22 millions d’ha) sont en propriété privée.
- 5 ha = surface moyenne des parcelles détenues par les propriétaires, majoritairement des hommes,
- 35 % des terres cultivées (9 millions d’ha) appartiennent aux agriculteurs qui les travaillent.
- 14 = nombre moyen de propriétaires avec lesquels contractualise un agriculteur qui exploite des terres en location.
Source : Terres de liens
FRICHES AGRICOLES, DES ESPACES A VALORISER
Abandonnées du fait de la déprise agricole ou des promesses d’un marché foncier plus rémunérateur, les friches agricoles sont un levier pour (re)développer une agriculture porteuse de durabilité. En région Occitanie, elles occupent 1,2 % du territoire (soit 91 140 ha) et près de 2,5 % de la SAU (projet SCO Friches agricoles, 2022-2024). En banlieue de Perpignan, des acteurs de la filière bio (expéditeurs et transformateurs) ont recensé 1 000 ha de friches irrigables afin d’installer des producteurs et relocaliser ainsi leurs approvisionnements, tandis qu’un groupement d’éleveurs de brebis exploite des friches agricoles périurbaines pour être autonome en fourrage et maintenir l’élevage de montagne (projet Fricato, 2015-2017). Plus largement, les friches agricoles sont souvent ciblées pour mettre en œuvre des politiques de transition environnementale, agricole et/ou énergétique que le projet Frichagri (2025-2028) analysera au prisme des rapports de force qui les sous-tendent.
Des freins et des leviers à la transition agroécologique
« S’inscrire dans une démarche agroécologique constitue un changement de monde professionnel qui coûte aux agriculteurs qui le vivent », considère Xavier Coquil, chercheur INRAE en ergonomie, spécialiste des questions de transitions professionnelles et de leurs accompagnements. « Ils savent ce qu’ils quittent mais ne savent pas vers quoi ils vont, et entre les deux il y a une expérience à acquérir qui nécessite de faire le deuil d’expériences passées. Il s’agit d’un changement de façons de faire mais aussi de façons de penser : la relation au vivant, mais aussi au milieu socioprofessionnel qui évolue progressivement à partir d’une impulsion initiale. »
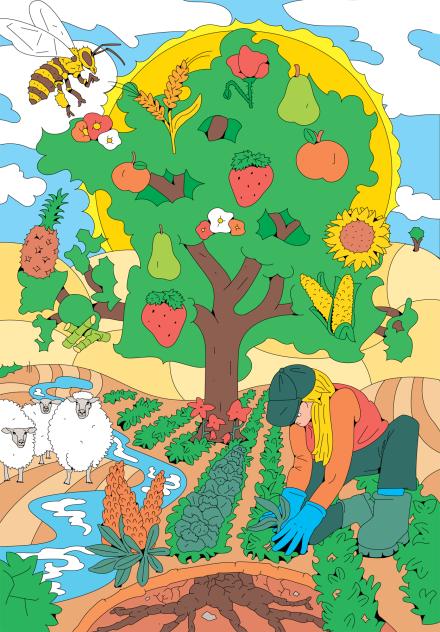
Des verrouillages sociotechniques peuvent empêcher la transition vers l’agroécologie à plusieurs niveaux :
- au niveau individuel, le manque de connaissances concernant de nouvelles pratiques agricoles, et l’absence de conseils adaptés ; l’attachement de certains agriculteurs aux rendements de l’agriculture conventionnelle, plus élevés à court terme et donc sécurisants ;
- au niveau de l’exploitation agricole, le manque de terres disponibles pour développer des pratiques alternatives ou l’importance d’investissements déjà réalisés qui doivent être rentabilisés dans un système technique donné ; ou encore des matières premières et des équipements pas toujours adaptés ;
- au niveau des filières, l’incertitude d’avoir des débouchés pour sa production, du stockage à la vente en passant par la transformation éventuelle ;
- au niveau des territoires, où les règles de gestion des ressources naturelles doivent être réadaptées pour permettre certaines pratiques (propriété de l’arbre, gestion de la vaine pâture…) ;
- au niveau national, l’absence de connaissances scientifiques ou le manque de soutien des politiques publiques pour accompagner les agriculteurs ; les besoins de données et d’éléments de réassurance pour évoluer vers de nouveaux systèmes de production.
Néanmoins, « en allant vers des pratiques agroécologiques, le producteur reprend la maîtrise de son métier […]. C’est plus risqué, mais cela apporte davantage de satisfaction au travail », affirme Emmanuel Poussard, psychologue du travail CNAM (Vaucluse agricole, 2023).
L’analyse des parcours d’agriculteurs engagés dans une agriculture plus durable révèle des émotions positives dans leur relation aux autres (montrer, faire ensemble, recevoir des connaissances héritées…) ou leur rapport à l’exploitation (connaître sa terre, expérimenter, se laisser surprendre…). Ces éléments positifs sont également susceptibles de renforcer l’attractivité des métiers et d’impulser le réengagement. L’adoption de pratiques relevant de l’agroécologie par des agriculteurs fragilisés mais soucieux de redresser et conserver leur ferme s’est révélée bénéfique sur le plan économique, mais aussi grâce à la reconquête de l’autonomie, du plaisir au travail, du sens et de la cohérence retrouvés.
NOUVELLES PRATIQUES, UN ENGAGEMENT COMPLEXE
Dans son récent travail de thèse, Camille Berrier, ingénieure INRAE en psychologie sociale, montre que l’engagement des éleveurs dans des pratiques agroécologiques relève du sens qu’ils accordent à leur travail. Un sens façonné par leurs investissements et expériences dans différents contextes de socialisation, par leur rapport au territoire, aux politiques publiques, aux institutions…, mais aussi par leurs rapports personnels (histoire familiale, parcours professionnel, etc.) et interpersonnels (histoire du métier, pairs, etc.).
CA-SYS, tester l’agroécologie à grande échelle

La plateforme CA-SYS est un dispositif collaboratif d’expérimentation en agroécologie de 125 ha, porté par INRAE et installé en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle permet d’évaluer la faisabilité de systèmes agroécologiques porteurs d’innovations de rupture. Pour cela, elle renouvelle les méthodes expérimentales en combinant sélection variétale, minimisation des intrants, valorisation des interactions biologiques et organisation de l’espace agricole.
Collaborative, elle associe des agriculteurs et agricultrices, des techniciens, des enseignants, des chercheurs et accueille, chaque année, quelque 150 étudiants des filières de l’enseignement agricole (BTSA), au bénéfice de l’agriculture de demain.
Les femmes, actrices de la transition agroécologique

Les femmes agricultrices sont souvent à l’initiative du passage en bio dans les exploitations. Très sensibles à la santé de leur famille et aux enjeux environne- mentaux, elles sont par ailleurs majoritairement celles qui assurent le travail administratif et comptable des fermes et sont donc au fait de la situation économique de celles-ci ; enfin ce sont souvent elles qui créent des ateliers sur la ferme, notamment pour recréer plus de liens avec les consommateurs (FNAB, 2018). En 2020, elles représentaient un quart des chefs d’exploitation, coexploitants ou associés dans les exploitations AB.
Même motivation en ce qui concerne plus généralement la mise en œuvre de pratiques agroécologiques portées avant tout par l’attention et le soin à l’autre (projet Transae, 2016-2020).
Construire la cohérence des politiques publiques
L’urgence à lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité, la nécessité de préserver la souveraineté agricole et alimentaire du pays impliquent de donner à notre agriculture les moyens de relever ces défis conjugués à celui du renouvellement des actifs. Si la formation en agri- culture et l’installation relèvent directement de politiques agricoles, l’agriculture et ses conditions d’exercice dépendent fortement des politiques alimentaires, environnementales, énergétiques et commerciales. Pour cela, des politiques plus transversales gagneraient à traiter simultanément des enjeux d’agriculture, d’alimentation et d’environnement, voire de santé (en savoir plus).
À l’échelle de l’Europe, la Politique agricole commune (PAC) est la seule véritable politique intégrée. Elle soutient les jeunes agriculteurs installés, mais ne présente pas de dispositifs dédiés à l’installation ou à la transmission. Son « verdissement » a été initié au tournant des années 2000 avec l’instauration, d’une part, de « l’écoconditionnalité » des aides directes et, d’autre part, d’un second pilier. « La liberté étant laissée aux États membres de mettre en œuvre l’écoconditionnalité, ceУe mesure sera finalement peu appliquée. Les mesures du second pilier en faveur de l’environnement et les mesures agri-environnementales ont eu peu d’impact », résume Cécile Détang-Dessendre, économiste INRAE. Depuis, l’agriculture et les systèmes alimentaires ont été au cœur de développements politiques qui font une part (plus) belle à l’agroécologie, considérée désormais comme une approche prometteuse pour accompagner la transition vers une agriculture plus durable, notamment avec les stratégies « De la ferme à la table » et « Biodiversité à l’horizon 2030 », en lien avec le Pacte vert pour l’Europe (2019) et la nouvelle PAC (2023-2027).
Les mesures en faveur du renouvellement des générations sont portées par d’autres textes parmi lesquels le rapport final du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’UE, paru en septembre 2024, qui explicite les enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels fait face l’agriculture européenne. Au nombre des recommandations mises en avant : renforcer la position des agriculteurs et agricultrices dans la chaîne de valeur alimentaire, soutenir des pratiques agricoles durables, adopter de nouvelles mesures visant à mieux préserver et gérer les terres agricoles, sans oublier la question du renouvellement des actifs. La France compte « parmi les pays du monde qui ont adopté les politiques d’agroécologie les plus explicites et les plus ambitieuses ». Il est également le seul pays européen à avoir développé un cadre de politique publique autour de l’agroécologie (projet AE4EU, 2021-2024).
Le Pacte pour le renouvellement des générations en agriculture et la loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 mai 2024, s’articulaient autour de deux défis majeurs : as- surer le renouvellement des générations et mener les transitions agroécologiques et climatiques. Ce projet de loi fixait un cap : « au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation 2025-2035 ». Des chiffres équivalents à ceux de 2020, soit la perspective de remplacer tous les départs en retraite. L’ambition était que la moitié des exploitations agricoles soient engagées dans des pratiques agroécologiques à l’horizon 2025. Le Pacte envisageait de renouveler la formation des agriculteurs à l’aune des nouvelles connaissances en agroécologie, levier indispensable dans la réussite de ces transitions.
Faciliter les conditions d’accès au métier et encourager les projets en agroécologie est déterminant pour l’installation des agriculteurs, mais pas seulement… Les conditions d’exercice de leur profession et la viabilité de l’exploitation sont également décisives pour réussir et pérenniser leurs projets.
-
Catherine Foucaud-Scheunemann
Rédactrice
Mission communication -
Cécile Detang-Dessendre, Nathalie Hostiou et Laurent Piet (INRAE), François Purseigle (INP Toulouse)
Pilotes scientifiques
-
Lionel Serre
Illustrateur
