Dossier revue
Société et territoiresFormation et innovation au cœur des transitions
La moitié des agriculteurs et agricultrices présents en 2020 partiront à la retraite d’ici 2030, tandis qu’un nombre croissant de personnes sans lien avec le monde agricole s’installent. Ce paysage socio-démographique renouvelé peut-il constituer une opportunité pour assurer notre souveraineté alimentaire tout en s’adaptant à l’urgence climatique ? Analyse.
Publié le 06 mars 2025
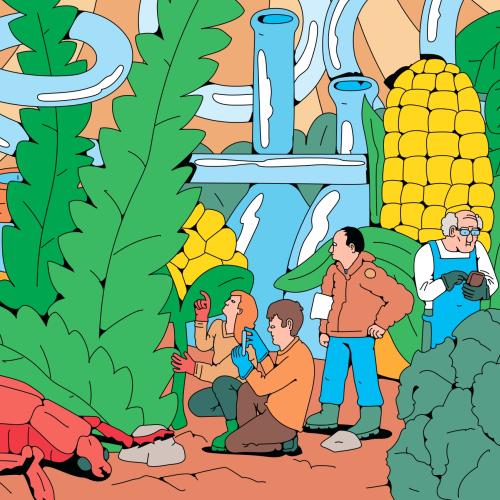
La transition vers des systèmes plus durables est un projet complexe à penser et mettre en œuvre, du fait de la multiplicité des acteurs à engager et des processus en jeu, des savoirs à intégrer, des niveaux d’organisations à considérer… L’enseignement agricole compte parmi les premiers maillons.
Apprendre et se former à travers l’enseignement agricole
Depuis la rentrée scolaire 2008 ont été mises en œuvre d’importantes rénovations des diplômes relevant de l’enseignement technique agricole, marquées en particulier par la prise en compte accrue du développement durable et de la diversité des systèmes de production agricole. Aujourd’hui, la totalité des référentiels de formation, auxquels INRAE a contribué, intègrent transitions, bien-être animal et agroécologie. Au sein des établissements, les exploitations, les ateliers technologiques et les nombreux projets de terrain permettent aux élèves d’expérimenter des outils et des méthodes, mais aussi de rencontrer les acteurs du territoire, partenaires de leurs futures activités.
Après une baisse de 5,5 % entre 2012 et 2018, les effectifs de l’enseignement agricole ont augmenté de manière constante, avec une hausse de 4 % du nombre d’élèves, apprentis et étudiants formés entre 2019 et 2022.
Cette attractivité renouvelée a été servie par des plans et actions d’envergure, auxquels INRAE a été associé. Deux plans successifs « Enseigner à produire autrement » ont été mis en place par le ministère en charge de l’Agriculture : le premier destiné à généraliser l’agroécologie dans l’enseignement agricole (2014-2019) et le second consacré à amplifier la dynamique (2020-2024). Ils ont agi sur les équipes pédagogiques et les apprenants, les référentiels de diplômes, mais aussi sur les exploitations agricoles et ateliers technologiques servant de supports pédagogiques, ainsi que sur les modes de gouvernance au sein des établissements et des territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
Dès 2019, une stratégie de communication pluriannuelle a été mise en place pour informer et orienter les jeunes vers les métiers et formations de l’enseignement agricole. Dans son sillage, une campagne est déployée pour mieux faire connaître l’étendue des métiers du vivant et les perspectives d’emplois qu’offrent ces filières. Deux ans plus tard, la campagne France Relance « L’enseignement agricole, #CestFaitPourMoi » porte deux enjeux majeurs : proposer une vision d’avenir pour l’agriculture et montrer son potentiel de recrutement pour favoriser le renouvellement des générations chez les agriculteurs et agricultrices.
Côté enseignement supérieur, les écoles d’agronomie, publiques ou privées, offrent des formations de type master en agroécologie, de portée nationale ou internationale, et déclinent les transitions au travers de leurs enseignements et pratiques. En partenariat avec les organismes nationaux de recherche, les instituts techniques et les universités, elles conduisent également des travaux de recherche dans le but de relever les grands défis actuels.
L’attractivité pour ces métiers et formations a aussi été portée à l’échelle européenne. Les projets du programme Erasmus+ permettent notamment d’innover sur des thèmes prioritaires comme l’agroécologie, l’adaptation des cultures aux bouleversements climatiques ou la souveraineté alimentaire. En 2022-2023, plus de 10 000 élèves et étudiants de l’enseignement agricole sont partis en mobilité de stage ou d’études avec une bourse et un accompagnement Erasmus+.
Seulement, l’enseignement agricole ne peut être seul porteur des changements attendus, et l’apprentissage du métier met en lice différents acteurs (familles, pairs, conseils, filières…) susceptibles de limiter l’influence de l’apport de l’institution scolaire sur les pratiques agricoles.
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE EN 2023-2024
- 802 établissements d’enseignement technique agricole de la 4e au BTSA
- 16 établissements d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et du paysage, de la licence au doctorat, publics et privés
- 216 000 élèves, étudiants et apprentis dans l’enseignement technique et supérieur (contre 190 000 en 2020).
Favoriser les transitions
La formation continue a également un rôle clé à jouer dans les transitions. Elle est assurée par un maillage important d’établissements publics, comme les Centres de formation professionnelle et de promotion agricole, qui délivrent des diplômes agricoles équivalents au baccalauréat. Ceux-ci permettent notamment à toutes personnes en reconversion professionnelle d’acquérir la capacité professionnelle agricole nécessaire à l’obtention des aides à l’installation. Des formations non diplômantes sont également proposées par des associations et d’autres structures.
Accompagner les agriculteurs dans leur quotidien
Mettre en œuvre des pratiques en phase avec les enjeux actuels de l’agriculture dans une exploitation agricole requiert un accompagnement sur mesure, inscrit dans la durée.
Des travaux conduits dans le secteur de Roquefort auprès d’éleveurs ovins montrent que la nature du conseil dispensé par des conseillers des chambres d’agriculture évolue : il n’est plus seulement technique mais aborde des sujets sociaux, sociétaux et d’organisation. La relation entre agriculteurs et conseillers agricoles se transforme pour aller vers plus de co-construction (projet ATA-RI, 2016-2021).
Même constat en élevage bovin : dans le cadre d’une communauté d’apprentissage par la pratique réunissant agriculteurs, accompagnateurs des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM), enseignants de lycées agricoles et scientifiques, les accompagnateurs se sont recentrés sur l’activité vécue par les agriculteurs en questionnant les sphères professionnelles, personnelles voire intimes qui la conditionnent (projet Transae : 2016-2020).
Ces travaux font ressortir la nécessité de développer des collaborations au sein des organismes et entre organismes à l’échelle d’un territoire. Ils posent enfin la question des mandats qui sont confiés aux conseillers par les organismes qui les emploient et de l’action publique en matière d’accompagnement en agriculture. L’intérêt et la faisabilité de dispositifs d’échanges entre conseillers, au sein de leur organisation ont d’ores et déjà été évalués auprès d’une dizaine d’organisations de conseil réparties sur le territoire français, en se basant sur l’analyse des situations de travail. Les conseillers comme leurs responsables de service ont reconnu la plus-value qu’apporte la mise en place de ces dispositifs pour les aider à faire évoluer leurs activités.

Les medias, facilitateurs de l'acculturation
Au sein de la population agricole, 46 % des personnes se disent « connectées par obligation », 23 % connectées « utiles » pour gagner du temps et 31 % « hyper connectées », considérant internet comme un véritable outil du quotidien dont elles ne peuvent plus se passer. Les internautes sont un peu plus jeunes que l’ensemble de la population agricole ; 68 % d’entre eux sont présents sur les réseaux sociaux, privilégiant d’abord YouTube (57,5 %) puis Facebook (54 %) et WhatsApp (51,4 %) (étude Agrinaute, 2022).
Dans une démarche agroécologique, les médias sociaux apportent de l’aide, depuis le déclenchement du questionnement initial jusqu’à la consolidation des pratiques, la possibilité d’animer un groupe, l’opportunité de concevoir et proposer une offre de service pour accompagner et soutenir la transition agroécologique… Plus qu’un outil de massification des pratiques, les réseaux sociaux sont un complément à des interactions humaines en présentiel, essentielles pour construire la confiance nécessaire aux changements de pratiques.
Et dans les faits ? La majorité des agriculteurs engagés dans des pratiques agroécologiques sont des habitués des médias sociaux : 60 % d’entre eux échangent depuis plus de 3 ans et 30 % depuis 1 à 3 ans. En revanche, la majorité des usagers a une présence peu visible en ligne : 6 % seulement jouent un rôle d’animateur/modérateur, 44 % ne font que consulter les échanges tandis que 35 % y contribuent.
Si les dimensions techniques ont une part importante dans ces échanges, les dimensions de réassurance et de soutien émotionnel sont bien présentes (projet Agor@gri, 2019-2022).
INRAE, partager les connaissances…
La formation à et par la recherche fait pleinement partie des missions d’INRAE. Elle s’inscrit dans la continuité recherche-innovation-développement-formation soutenue par des liens étroits avec les instituts techniques agricoles et les chambres d’agriculture. De façon volontaire, INRAE s’engage également dans la formation initiale (environ 29 000 heures/an dispensées dans l’enseignement technique et supérieur), la formation tout au long de la vie et la sensibilisation.
Partager les connaissances est un enjeu d’autant plus primordial dans le contexte d’un renouvellement conséquent des actifs agricoles. Face aux transitions, l’intérêt des apprentissages collectifs et de la co-construction de solutions fait ses preuves. Le dispositif d’INRAE s’est diversifié et se renforce à hauteur des enjeux actuels.
Citons les unités et réseaux mixtes technologiques (UMT et RMT) issus de la Loi de modernisation agricole de 2006. Ces formes de partenariat reposent sur des équipes communes, qui associent en un même lieu (cas des UMT) ou dans le cadre de réseaux (cas des RMT) des chercheurs et des ingénieurs, notamment d’instituts techniques agricoles, mais aussi des conseillers et des enseignants ou, pour les RMT, des chefs d’exploitation ou des enseignants de lycées agricoles. INRAE participe à 28 UMT sur 38 en activité, avec 130 ETP mobilisés, et 29 RMT sur 30, aux côtés d’une cinquantaine de lycées agricoles.
Le projet NEFERTITI (2018-2022), dont INRAE était partenaire, a mis en place un réseau de fermes pilotes et de démonstration à l’échelle de l’Union européenne. Conçu pour améliorer les échanges de connaissances et l’adoption de l’innovation dans le secteur agricole, ce projet a réuni chercheurs, agriculteurs, conseillers agricoles et étudiants autour des défis agricoles actuels.
Au quotidien, au cœur de ses 18 centres de recherche, INRAE et ses équipes accueillent étudiants, agriculteurs et autres acteurs du monde agricole lors de stages, de visites ponctuelles d’unités ou d’installations expérimentales.

Pas moins de 15 000 agriculteurs visitent chaque année les unités expérimentales de l’institut et échangent avec chercheurs, ingénieurs ou techniciens.
« L’organisation de l’enseignement agricole français facilite aussi le lien entre les fermes des lycées agricoles, les instituts techniques agricoles et les unités INRAE. À travers une grande diversité d’action, les unités expérimentales de l’institut permettent aux univers de la recherche et de l’enseignement technique agricole d’échanger sur la mise en pratique des avancées des connaissances techniques », détaille Dominique Grevey, directeur de l’Enseignement supérieur, des sites et de l’Europe à INRAE.
GECO
Site internet collaboratif d’échange, de mise à disposition et de partage de connaissances utiles à l’action autour de la protection intégrée des cultures, de l’agroécologie et de l’adaptation au changement climatique. Les connaissances proposées sont éprouvées scientifiquement ou issues de savoir-faire et de retours d’expériences.
+ de 2 000 fiches construites collectivement sur GECO.
… et les produire de manière collective
Et si les connaissances et les innovations pouvaient être produites de manière collective ? C’est tout l’objet des sciences et recherches participatives dans lesquelles sont mobilisés citoyens et professionnels pour faire avancer la science et dans lesquelles s’investissent les équipes INRAE. Par exemple, le projet EcoVitiSol, lancé en 2019 et coordonné par Lionel Ranjard, chercheur INRAE en écologie des sols, s’emploie à comparer la qualité microbiologique des sols viticoles en fonction du mode de production agricole, sur des réseaux de parcelles de viticulteurs impliqués dans le projet. Autre exemple, le projet DIVINFOOD (2022-2027) coordonné par Yuna Chiffoleau, sociologue INRAE, vise à développer des chaînes alimentaires valorisant la biodiversité agricole sous-utilisée. En pratique, il étudie des céréales et légumineuses mineures (petit épeautre, blé amidonnier, blé Poulard, pois carré, haricot commun, lupin, fève, pois, lentille), dans trois zones géographiques de l’Europe, qui font face à divers aléas climatiques et défis socio-économiques en s’appuyant notamment sur neuf living labs.
LIVING LAB (OU LABORATOIRE VIVANT)
Regroupement d’une grande diversité d’acteurs issus du secteur public ou privé, du monde associatif ou individuel, autour d’un enjeu commun sur territoire donné, dans l’objectif d’expérimenter en conditions réelles des services, des outils ou des usages nouveaux.
Le projet ALL-Ready (2020-2023), coordonné par Heather McKhann, chargée de mission Europe à INRAE, a permis de produire un cadre pour le futur réseau européen de living labs et d’infrastructures de recherche au service de la transition agroécologique « En partageant des connaissances qui peuvent être très locales, les acteurs et actrices des living labs vont structurer un réseau et ainsi l’élargir pour avoir plus d’impact tout en changeant d’échelle », résume la porteuse du projet. Le partenariat européen Agroécologie, auquel participe INRAE, poursuit le même but. Ses atouts ? « Un réseau à l’échelle européenne, en lien avec un important maillage de territoires d’expérimentation, et avec l’hypothèse que le développement de l’agroécologie peut être facilité par le recours aux living labs, pour identifier les innovations qui ont du sens pour les acteurs et auront le plus de chances d’être déployées ensuite », commente Yann Raineau, économiste INRAE et coordonnateur des activités de mise en place du réseau européen des living labs.
Renforcer les liens entre enseignement agricole et recherche
Outre sa contribution aux référentiels de formation et ses liens étroits avec l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, INRAE s’investit pour participer à la formation des formateurs de l’enseignement agricole afin de partager l’avancée des connaissances. En juillet 2023, INRAE et l’université de Toulouse ont organisé le 26e séminaire européen sur le conseil et l’enseignement agricole, l’occasion d’aborder ces sujets en lien avec le défi de la transition vers une agriculture durable.
-
Catherine Foucaud-Scheunemann
Rédactrice
Direction de la communication -
Cécile Détang-Dessendre, Nathalie Hostiou et Laurent Piet (INRAE), François Purseigle (INP Toulouse)
Pilotes scientifiques
-
Lionel Serre
Illustrateur
