Dossier revue
AgroécologieLes données, matière première des innovations agricoles
Pour soutenir la recherche et le passage à l’échelle de solutions actionnables par l’agriculture, l’IA s’appuie sur de nombreuses données. C’est grâce à la qualité de celles-ci qu’elle peut aider les professionnels à anticiper les risques sanitaires ou climatiques, à optimiser l’emploi d’outils de production ou de gestion, et les soulager dans l’exécution de tâches répétitives. Revue.
Publié le 30 juillet 2025
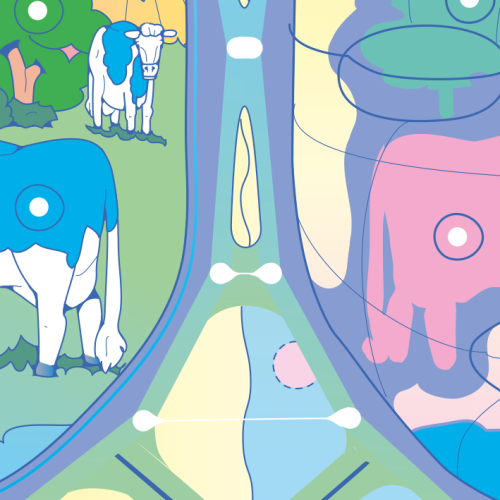
En agriculture comme ailleurs, les usages de l’IA stimulent la recherche. « L’IA vient compléter les outils statistiques qui sont en place depuis longtemps. Elle apporte des briques supplémentaires qui permettent par exemple d’estimer les résultats d’expériences coûteuses à mener en conditions réelles de terrain pour les orienter dès le départ dans la bonne direction. On observe aussi des progrès qualitatifs, là où des modèles prédictifs existent déjà, notamment avec les jumeaux numériques de ferme. Alors qu’ils sont complexes à construire et à valider, l’IA nous aide à les améliorer et à affiner leurs paramètres », explique Vincent Guigue, spécialiste en science des données et professeur en informatique à AgroParisTech. Il accompagne la montée en puissance de l’IA dans l’enseignement et la recherche.
Selon Pauline Ezanno, cheffe du département Santé animale d’INRAE, la formation des chercheurs à l’IA est en effet un des défis actuels à relever dans la recherche publique. La chercheuse questionne « le risque de voir émerger une recherche à deux vitesses avec ceux qui restent sur le quai et ceux qui montent dans le TGV de l’IA. » Les profils de chercheurs en capacité de mobiliser des méthodes d’IA poussées sont aujourd’hui très sollicités dans le secteur agronomique comme dans d’autres secteurs.
Deep learning, IA générative… toutes les formes d’IA sont utilisées dans les recherches à la source d’innovations pour l’agriculture. Leur apport s’appuie sur la qualité des données collectées : deux exemples éloquents en sont les jumeaux numériques et la vision satellite.
Jumeaux numériques, des outils tactiques et stratégiques
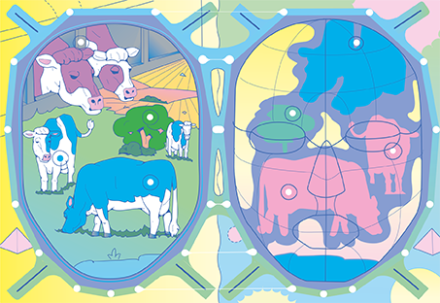
Un jumeau numérique désigne une modélisation la plus complète possible d’un procédé industriel, d’une machine ou d’un phénomène naturel, dans le but d’en assurer le suivi et la maintenance. Par rapport aux modèles et simulations classiques, l’originalité réside ici dans l’échange de données entre une entité réelle (le jumeau réel) et une entité virtuelle (le jumeau numérique). Dans un modèle classique, un modélisateur humain intervient pour transmettre des résultats expérimentaux à un modèle, ou des résultats de simulation à des interventions sur le système réel. Dans le cas d’un jumeau numérique, la synchronisation est plus aboutie entre les jumeaux, le réel et le virtuel, grâce à l’automatisation plus ou moins poussée du flux de données entre les jumeaux.
La construction de ce miroir de la réalité fait appel à différentes techniques de science des données et d’IA basées sur l’observation dynamique et la modélisation physique des systèmes ciblés. Il simule par anticipation les comportements de ces systèmes dans des conditions variées, des plus classiques au plus extrêmes, permettant ainsi un pilotage optimisé, en collaboration avec l’opérateur humain.
En agriculture, avec l’augmentation du nombre de capteurs au sein des fermes, et la quantité de données récoltées, le jumeau numérique d’une exploitation agricole peut devenir une aide au quotidien pour l’agriculteur-éleveur. Il va lui permettre par exemple d’ajuster ses tactiques de cultures ou d’élevage en fonction de séquences climatiques prédites à court ou moyen terme. Capable de produire des scénarios prospectifs, un jumeau numérique peut aussi aider à se projeter dans le futur pour anticiper des changements au sein d’une exploitation (voir les encadrés sur les projets Twinfarms et InSiliCow).
La nouvelle puissance des observations depuis l’espace
Autres domaines en pleine évolution : la télédétection par satellite et le traitement d’images, qui procurent des informations sur la croissance des cultures, notamment leur hauteur, et que les chercheurs commencent à exploiter. Pour cela, il est nécessaire de traiter un grand nombre de données.
Cette analyse mobilisait, avant l’émergence de l’IA, de longues heures de travail d’experts afin d’analyser et de traduire ces images en une information technique utile. Désormais, l’utilisation de l’IA permet de gérer plus rapidement et en toute autonomie cette masse d’informations. Dans le secteur forestier, une révolution sur ce sujet est en cours depuis 3 ans. « De grands verrous bloqués depuis 50 ans ont sauté grâce à l’IA, car on peut désormais réaliser des cartes de contours des arbres, de leur hauteur et cela individuellement. À partir de là, on peut estimer la biomasse, les stocks de carbone, suivre leurs évolutions et bientôt la biodiversité », explique Jean-Pierre Wigneron, directeur de recherche à INRAE (UMR Interactions sol-plante-atmosphère). Il est désormais possible de suivre la croissance annuelle des forêts et l’évolution de leur biomasse sur les 10 dernières années à une résolution de 30 mètres, d’estimer leur état sanitaire et les zones à risque (dégradations liées aux activités humaines, feux, dépérissements liés aux sécheresses et aux attaques parasitaires).
« De grands verrous bloqués depuis 50 ans ont sauté grâce à l’IA, car on peut désormais cartographier les arbres individuellement (à partir de données spatiales). »
Jean-Pierre Wigneron
Dans le cadre du projet international One Forest Vision auquel participe INRAE, ce suivi est aussi réalisé pour les forêts d’Afrique du bassin tropical pour lesquelles les premières cartes ont été produites. « Maintenant, nous cherchons à appliquer ces mêmes méthodes à l’agriculture pour faire un suivi similaire de la croissance des cultures, en quasi-direct, pour obtenir des alertes liées à des attaques phytosanitaires. Pour le moment, cela reste plus difficile parce que, par exemple, sur des estimations de hauteur, les variations des arbres sur 1 an sont importantes alors que pour l’agriculture nous sommes sur des variations de quelques centimètres par mois. Mais les choses vont vite évoluer », estime Jean-Pierre Wigneron.
Au cœur de l’équipe-projet Evergreen, en partenariat entre INRAE, l’Inria et le Cirad, l’objectif est également de faire avancer l’exploration des données satellitaires et de trouver, grâce à l’IA, de nouvelles techniques d’analyse dans les secteurs de l’agriculture et l’environnement. À travers ce programme démarré en 2024 pour 10 ans, « un projet de suivi sur la déforestation en Afrique est mené avec l’université de Wageningen et un projet de cartographie d’occupation du sol sur l’île de la Réunion est financé par #DigitAg », détaille Dino Ienco de l’UMR Tetis, responsable de cette équipe-projet.
Projet Twinfarms : Jumeaux numériques en construction
Le projet Twinfarms, lancé en février 2025, est lauréat d’un appel à projets du PEPR Agroécologie et numérique. Il est porté par la chaire de mécénat Alliance H@rvest de la Fondation AgroParisTech et mobilise de nombreux partenaires dont l’Acta. En 4 ans, l’objectif de Twinfarms est de déployer 9 démonstrateurs de jumeaux numériques. Répartis en France, les 9 cas d’usage seront évalués sur leur valeur ajoutée pour assister les choix tactiques ou stratégiques dans un contexte de transition agroécologique. « Nous travaillerons à ce que la construction des jumeaux numériques de ces 9 démonstrateurs permette de faire émerger des composants génériques utiles aux développements futurs et réutilisables par d’autres exploitations », explique Sophie Martin, chercheuse à INRAE et coordinatrice du projet TwinFarms. Cinq contrats de thèses sont financés dans le cadre du projet.
Projet inSiliCow : Ferme virtuelle
Les chercheurs INRAE Charlotte Gaillard (UMR Pegase) et Olivier Martin (UMR MoSAR) sont co-porteurs d’un projet de jumeau numérique fondé sur le simulateur inSiliCow. Cet atelier laitier virtuel est destiné à piloter un élevage réel de vaches laitières. Démarré en 2024 pour 4 ans, inSilicow est un projet phare du métaprogramme DIGIT-BIO conduit par INRAE. En utilisant l’IA, le jumeau numérique créera des simulations multi-échelles sur lesquelles différentes stratégies de gestion des individus, du troupeau et du système d’élevage pourront être testées. « On peut notamment prédire la production de lait et sa composition pour la lactation suivante, selon différents scénarios d’alimentation », détaille Charlotte Gaillard. La ferme virtuelle devient ainsi un outil d’aide à la décision pour l’éleveur pour améliorer les performances économiques, sociales et environnementales de son élevage.
-
Anne-Lise Carlo
(Envoyer un courriel)
Rédactrice
-
Véronique Bellon-Maurel, Jean-Pierre Chanet, Claire Rogel-Gaillard
Pilotes scientifiques
