Dossier revue
Alimentation, santé globaleManger sain et durable, les fondamentaux
Publié le 05 janvier 2023 (mis à jour : 05 avril 2021)

Si nous ne mangions que des produits gras et sucrés dont la production est peu émettrice de gaz à effet de serre (GES), notre régime alimentaire aurait un faible impact sur l’environnement, mais un impact délétère sur notre santé. Si nous supprimions sodas, charcuterie et chips pour nous nourrir essentiellement de fruits, de légumes, de produits laitiers et de poissons, notre régime serait sain mais difficilement acceptable socialement par une grande partie de la population. Et s’il existait un régime alimentaire, à la fois sain, plus respectueux de l’environnement et acceptable, encore faudrait-il qu’il soit accessible à tous d’un point de vue économique.
La durabilité, au-delà des questions environnementales
Pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture1, la durabilité d’un régime alimentaire repose sur plusieurs critères : il doit avoir un faible impact sur l’environnement ; contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population ; être culturellement acceptable, économiquement équitable et accessible. Mais les situations culturelles, économiques, sociales et agricoles sont tellement diverses de par le monde qu’il est impossible de définir « un » régime alimentaire unique que pourrait adopter la population mondiale. Il existe ainsi une diversité d’évolutions envisageables et souhaitables de nos régimes alimentaires.
Pour ce qui est de la France, l’État s’appuie sur les recommandations nutritionnelles émises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), pour établir le Programme national nutrition santé (PNNS), support de politiques publiques dont l’objectif est d’améliorer la situation nutritionnelle et de santé de la population. Voici les grandes lignes de ce plan : réduire notre consommation de produits et boissons sucrés, de charcuterie et de viandes (hormis la volaille) ; maîtriser la consommation d’aliments hautement transformés ; consommer des poissons issus de stocks durables ; mettre l’accent sur des aliments locaux et saisonniers ; augmenter notre consommation de produits végétaux de bonne qualité nutritionnelle comme les céréales complètes, les légumineuses, les fruits et légumes… Ces recommandations permettent de tendre vers un régime plus sain mais permettent-elles d’avoir un impact moindre sur l’environnement ? Pour répondre à cette question, les chercheurs d’INRAE se sont penchés sur les régimes des Français.
L’impact environnemental des régimes alimentaires
Les études (Inca 3 2014-2015, expertise collective Anses 2017, Credoc 2013) sur la population française montrent que les 20 % de personnes ayant le meilleur régime alimentaire, d’un point de vue nutritionnel, consomment moins de viande, charcuterie, boissons sucrées et alcoolisées, et plus de produits végétaux que la moyenne. Ce faisant, leur régime émet 18 % de GES en moins et est ainsi plus respectueux de l’environnement.
Rééquilibrer nos apports entre protéines d’origine animale et végétale est une des clés des transitions.
Pour aller plus loin, les chercheurs ont conçu par modélisation un régime qui répond aux recommandations nutritionnelles et permet de diminuer davantage les émissions de GES. Résultat, avec une réduction plus forte des produits animaux, une augmentation des produits végétaux et une baisse de la consommation des boissons chaudes (café, thé, etc.), les chercheurs arrivent à un régime qui émet 30 % de moins de GES que le régime moyen actuel. Ces deux régimes, l’observé et le modélisé, ont un coût inférieur à celui du régime actuel (6,20 € et 6,40 € par jour par personne, au lieu de 6,70 €) mais restent tout de même inaccessibles pour une partie de la population – sachant que le budget moyen des Français se situe entre 5 et 6 € par jour et par personne, et celui des ménages les plus modestes autour de 3,50 €. Par ailleurs, la question de leur acceptation sociale et culturelle reste posée, en particulier pour la diminution de consommation de viande.

Si le régime alimentaire doit avant tout être sain et couvrir les besoins nutritionnels, il doit aussi être culturellement acceptable, économiquement accessible, avec un impact réduit sur l'environnement
1. ONUAA, ou en anglais FAO pour Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Quelle place pour la viande ?
Très inégale dans le monde (un Africain consomme 6 à 10 fois moins de viande qu’un Occidental, un Asiatique 2 fois moins), la consommation de viande devrait augmenter de 60 % d’ici 2050 selon les projections, du fait de l’augmentation conjuguée de la population mondiale et du pouvoir d’achat des pays en forte croissance. Or, si les produits animaux apportent tous les acides aminés dont nous avons besoin et constituent la source principale de vitamine B12, de fer et de zinc essentiels pendant la grossesse et la croissance, une consommation excessive de viande, en particulier de viande rouge, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Ses acides gras saturés et mono-insaturés peuvent entraîner des maladies cardiovasculaires. De récentes études, menées à l’unité mixte de recherche Toxicologie alimentaire (Toxalim), ont montré le lien entre la consommation excessive de viande rouge ou de charcuterie et le cancer du côlon.

Ce dossier propose des éléments de réflexion sur un sujet de préoccupation croissant dans nos sociétés occidentales : l’élevage et la consommation de viande. En tissant des liens entre différents résultats de recherche, il dégage, non pas des réponses simples, mais quelques pistes sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire son propre point de vue.
Par ailleurs, l’élevage, en particulier celui des ruminants, est responsable d’une partie des émissions de GES. En effet, au niveau mondial, les émissions directes et indirectes de GES provenant de l’élevage sont estimées à 14,5 %2 des émissions totales liées aux activités humaines, l’équivalent de 7,1 gigatonnes de CO2 chaque année. Enfin, le bien-être animal, préoccupation croissante dans la société, interroge certaines pratiques de production dans les élevages industriels. Mais s’il est indéniable qu’une diminution de la consommation de viande présente un intérêt environnemental, l’élevage a aussi ses vertus.
2. Émissions directes et indirectes liées à la production d’aliments, la consommation d’énergie, la fermentation entérique, etc. Source FAO : www.fao.org/3/i6345f/i6345f.pdf
L’élevage permet d’utiliser des terres agricoles non cultivables sous forme de prairies temporaires ou permanentes (plus de 5 ans sans culture) qui jouent un rôle majeur dans le stockage du carbone dans les sols. Les animaux permettent également la valorisation des coproduits et sous-produits des filières végétales non consommables directement par l’humain, ou encore apportent une fertilisation organique des terres. Enfin, si tout le monde adoptait un régime basé uniquement sur des produits végétaux, l’augmentation de la demande de ces produits ferait augmenter proportionnellement les besoins en terres cultivées et probablement la quantité de pesticides utilisés. Aussi, les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appellent à un rééquilibrage des apports entre produits végétaux et animaux. En France, il s’agirait ainsi de faire évoluer notre ratio de consommation de protéines d’origine animale et végétale de 65/35 à 50/50 en moyenne.
Manger durable, c’est penser système…
La consommation ne devrait pas se penser indépendamment de la production agricole. Un régime alimentaire durable commence par une production respectueuse de l’environnement. « C’est un cercle vertueux, produire mieux permet de manger mieux, et manger mieux permet d’impulser la demande pour une meilleure production », rappelle Sophie Nicklaus, spécialiste INRAE de l’étude du comportement alimentaire au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CSGA) à Dijon.
Les systèmes alimentaires sont responsables de près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Aujourd’hui, nos systèmes alimentaires (pratiques agricoles, procédés de fabrication de l’industrie agro-alimentaire, mode de transport, distance parcourue des produits, etc.) ont des impacts sur notre environnement : pollution de l’eau et des sols, émission de GES, déforestation, perte de biodiversité… et sur notre santé, puisqu’un environnement pollué et des pratiques non respectueuses de l’environnement augmenteront notre exposition à différents contaminants.
… et adopter des pratiques agricoles plus écologiques
Côté champ, il s’agit de développer des modèles plus respectueux de l’environnement. L’agroécologie en est un bon exemple. Le principe : des pratiques agricoles (biocontrôle, couverts végétaux hivernaux, associations de culture, prairies permanentes, etc.) qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes avec comme objectifs de réduire les émissions de GES, limiter le recours aux intrants de synthèse et préserver les ressources naturelles. L’agriculture biologique, caractérisée par l’absence d’utilisation d’intrants de synthèse et d’antibiotiques, est également une bonne voie pour verdir les pratiques agricoles avec en prime des impacts bénéfiques sur la santé. Des travaux récents basés sur le suivi de 69 000 personnes pendant 7 ans, dans le cadre de l’étude Bionutrinet, ont montré une diminution de 25 % du risque de cancer (tous types confondus) chez les consommateurs réguliers d’aliments issus de l’agriculture biologique, par rapport à ceux qui en consomment moins souvent. Les travaux de recherche se poursuivent pour expliquer de tels résultats. Pour Emmanuelle Kesse-Guyot, épidémiologiste INRAE au sein de l’Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (UMR EREN), plusieurs pistes sont à étudier : « des teneurs potentiellement plus élevées en certains micronutriments (antioxydants, caroténoïdes, polyphénols, vitamine C ou profils d’acides gras plus bénéfiques) dans les aliments bio, ou encore la présence de résidus de pesticides synthétiques plus fréquente et à des doses plus élevées dans les aliments issus d’une agriculture conventionnelle, en comparaison avec les aliments bio ».

Une diminution de 25% du risque de cancer a été observée chez les consommateurs « réguliers » d’aliments bio, par rapport aux personnes qui en consomment moins souvent. C’est ce que révèle une étude épidémiologique menée par une équipe de l’Inra, Inserm, Université Paris 13, CNAM, grâce à l’analyse d’un échantillon de 68 946 participants de la cohorte NutriNet-Santé. Bien que le lien de cause à effet ne puisse être établi sur la base de cette seule étude, les résultats suggèrent qu’une alimentation riche en aliments bio pourrait limiter l’incidence des cancers.
À ce stade, ce ne sont que des hypothèses, les chercheurs continuent d’évaluer les potentielles relations entre consommation de produits biologiques et santé, mais également sur les liens entre pesticides et maladies métaboliques (diabète, obésité, hypertension…) ou cancers. Mais ce qui est acquis, c’est qu’à l’échelle de l’individu, les grands consommateurs de bio ont adopté un régime beaucoup moins émetteur de GES car ils ont tendance à avoir un régime plus végétalisé que les autres consommateurs. Cependant, convertir toutes les surfaces agricoles en agriculture biologique (AB) aurait aussi ses limites : avec des rendements plus faibles, nourrir la planète en AB pose la question de la disponibilité de davantage de terres cultivables.
Manger moins, local et de saison ?
Si les études montrent que c’est la réduction de la consommation des produits animaux qui constitue le plus grand potentiel de diminution des GES, des actions complémentaires peuvent aussi y contribuer. Manger moins ? Les études citées plus haut indiquent que les régimes occidentaux doivent baisser de 250 kcal pour atteindre 3 000 kcal par jour et par personne, gaspillage compris (soit 1 850 à 2 000 kcal réellement consommées). Diviser par deux le gaspillage alimentaire des consommateurs permettrait de réduire les émissions de GES d’environ 5 % à l’échelle de la planète.
Diviser par deux le gaspillage alimentaire des consommateurs permettrait de réduire de 5 % les émissions de GES de la planète.
Quant au « manger local » très en vogue, il n’est pas forcément synonyme de durable. En effet, si le transport par avion fait grimper l’impact carbone d’un aliment, il représente seulement 1 % du tonnage des importations de fruits et légumes, et a donc un impact global limité. « Si on doit pointer du doigt un problème avec le transport des aliments, il faut plutôt regarder entre le lieu d’achat et le domicile qui peut aller jusqu’à 40 % de l’impact carbone d’un aliment », précise Nicole Darmon, épidémiologiste du Centre interdisciplinaire de Montpellier sur les systèmes agroalimentaires durables, sciences sociales et nutritionnelles (MOISA). Ainsi, aller chercher ses fraises chez le producteur « local » en voiture, n’est pas forcément plus durable que de consommer un produit importé. Manger de saison ? Là aussi, tout dépend de ce que l’on regarde. Pour Emmanuelle Kesse-Guyot, l’important est surtout de produire de saison pour limiter le recours aux serres chauffées, mais rien n’empêche de consommer en hiver du coulis de tomates produites en été !
Une alimentation accessible à tous
En dessous de 3,50 à 4 € par jour et par personne, il est très difficile d’avoir une alimentation à la fois saine et durable
Manger sain et durable a-t-il un coût pour le consommateur français ? Pour Nicole Darmon, l’impact serait faible. D’un côté, la diminution des achats de viande a tendance à faire baisser les coûts, d’autant plus qu’ils représentent le premier poste du budget alimentaire des Français. Manger plus de fruits et légumes peut en revanche faire augmenter les coûts, même avec les légumineuses pourtant moins chères. Mais Nicole Darmon alerte : « en dessous de 3,50 à 4 € par jour et par personne, il est très difficile d’avoir une alimentation à la fois saine et durable ». Par ailleurs, lorsque les personnes sont contraintes par leur budget, elles ont tendance à choisir des aliments qui apportent des calories bon marché, comme les produits céréaliers raffinés et les produits gras et sucrés. Ces produits - typiquement les chips et les biscuits - pauvres en nutriments essentiels sont souvent chargés en sucres ou en sel, ce qui, consommés à l’excès, les rend préjudiciables à notre santé. En revanche, ils sont pratiques, réconfortants et présentent l’avantage de moins se gaspiller…

Concilier la qualité nutritionnelle de notre alimentation, sa durabilité et s’assurer qu’elle soit accessible financièrement à toute la population est une équation complexe à résoudre. En mettant en œuvre des recherches action basées sur les enseignements tirés d’approches mathématiques appliquées à la nutrition, ou nutrition quantitative, Nicole Darmon, directrice de recherche à INRAE, explore plusieurs pistes pour résoudre cette équation.
Manger plus durable implique sans aucun doute de végétaliser notre alimentation. Mais attention, réduire la part des produits animaux ne servira la durabilité et la qualité de nos régimes que si c’est au bénéfice d’une grande diversité de produits d’origine végétale et de bonne qualité nutritionnelle tout en engendrant des changements envisageables pour le consommateur en matière d’habitudes et de budget. Si manger plus durable semble être à la portée des pays occidentaux tels que la France, cela nécessite une volonté politique forte pour mener de concert les transitions à tous les niveaux : production, transformation et consommation.
Prometteuses légumineuses
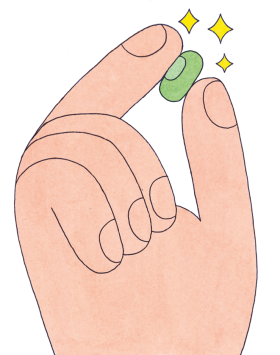
Pour résoudre l’équation complexe du régime sain et durable, les légumineuses font office aujourd’hui de bonnes candidates : lentilles, fèves, haricots secs pour l’alimentation humaine ; pois, féverole, trèfle, luzerne pour l’alimentation animale. À la fois bonnes pour notre santé et celle de l’environnement, elles sont un maillon essentiel de la transition vers des régimes durables.
Sources de protéines (20 à 40 % selon les espèces contre 10 à 13 % dans le blé par exemple), les légumineuses permettent de réduire notre consommation de viande et diminuer l’importation de soja pour l’alimentation animale. De surcroît, les légumineuses présentent des avantages sur le plan agronomique et même climatique. Intégrées dans les rotations de culture, elles peuvent servir de piège à nitrates et fixer l’azote pour la culture suivante. Elles permettent de casser le cycle des maladies, des ravageurs et des mauvaises herbes, et ainsi d’utiliser moins de pesticides à l’échelle de la rotation des cultures. Leur présence entraîne ainsi des gains de rendements pour les céréales et améliore la fertilité des sols… Malgré ces nombreux atouts, les légumineuses représentent seulement 4 % de la surface agricole utile en France et la consommation de légumes secs (lentilles, haricots, fèves, pois chiches, etc.) a été divisée par quatre en 20 ans pour atteindre un niveau très bas en France (2 kg par personne et par an en 2020 selon l’Agreste). Comment expliquer ce désamour ? Côté consommation, on peut incriminer le temps qu’elles peuvent nécessiter en cuisine, les désordres digestifs qu’elles peuvent provoquer ou encore un goût exacerbé de type « note verte ».
Elles sont également victimes de préjugés : des études montrent que les légumes secs sont associés à une alimentation végétarienne et ne sont pas perçus comme une source de protéines mais plutôt comme un accompagnement de la viande. Côté production, leur forte sensibilité aux stress climatiques, comme le gel ou la sécheresse, et leur faible résistance aux agresseurs biologiques conduisent à des rendements incertains. Négligées pendant des années, les filières de valorisation sont aujourd’hui assez peu structurées. La logistique est complexe et coûteuse pour des petits volumes. Aussi ces productions sont vues comme peu intéressantes économiquement en l’absence d’aides publiques.

Produire des légumineuses, c’est bon pour l’environnement et l’agriculture. En consommer, c’est bon pour la santé. Mais du champ à l’assiette, comment se structurent les filières ? Quels sont les freins et leviers à leur développement ? Entretien avec Marie-Benoît Magrini, économiste à INRAE et spécialiste des filières légumineuses.
Des faiblesses que les chercheurs tentent de dépasser, depuis la production jusqu’à la consommation, en passant par la transformation. Par exemple, ils développent de nouvelles variétés de pois et de féveroles plus résistantes à la sécheresse, au gel et aux maladies, ou encore de nouveaux produits à base de légumineuses. Un objectif soutenu directement par l’État français avec le « plan protéines végétales » lancé en 2020, qui vise à doubler en 10 ans la surface agricole utilisée pour les cultures riches en protéines végétales (soja, pois, légumes secs, luzerne, légumineuses fourragères…), pour atteindre 8 % de la surface agricole utile au niveau national.
-
Élodie Regnier / Anaïs Bozino
(Envoyer un courriel)
rédactrice
Direction de la communication
