Alimentation, santé globale Temps de lecture 3 min
Quelles alternatives en expérimentation animale ? Pratiques et éthique
Publié le 29 septembre 2020
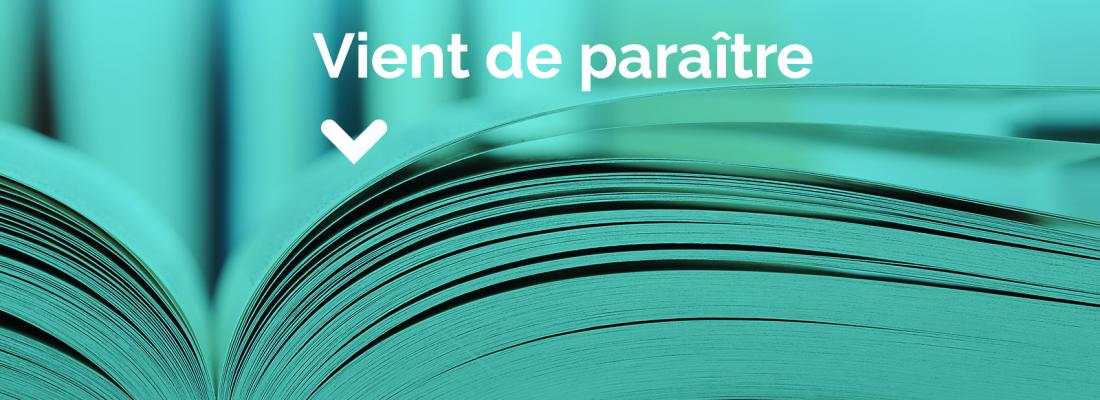
Le débat sur la place de l’animal dans nos sociétés industrielles est un important sujet de polémique. Son utilisation à des fins de recherches fondamentales ou appliquées, pour le développement des médicaments et des vaccins, pour la sécurité des produits chimiques fait l’objet de vifs échanges. Certains défenseurs du bien-être animal considèrent qu’il faudrait remplacer totalement l’expérimentation animale par des « méthodes alternatives » et s’opposent aux scientifiques et experts qui en soulignent la nécessité.
EXTRAITS
• Le concept 3R* a joué un rôle fondamental dans la prise de conscience que l’expérimentation animale devait s’accompagner d’une démarche éthique rigoureuse. La réduction de l’utilisation des animaux et la nécessaire intégration de leur bien-être dans la démarche expérimentale sont devenues obligatoires dans les protocoles présentés aux comités d’éthique. Parallèlement, ce concept a favorisé le développement des outils de la culture cellulaire et les approches de modélisation in silico. De nombreux tests ont été mis au point et validés en application de la démarche de substitution, comme les chapitres suivants vont l’illustrer.
* remplacement, réduction et raffinement.
• À la fin du xxe siècle, on considérait que les méthodes alternatives étaient essentielle- ment des méthodes in vitro, cultures de tissus, de cellules, voire des macromolécules biologiques, des acides nucléiques ou des protéines. Ces dernières années le concept s’est rééquilibré en mettant également en avant les efforts de réduction du nombre d’animaux dans les expériences, en particulier dans les tests réglementaires pour l’évaluation de la sécurité des substances chimiques et des médicaments, c’est le deuxième R. Pour le troisième R, le « raffinement », les progrès de l’imagerie du petit animal et de la métabolomique, c’est-à-dire une recherche plus intégrée de biologie systémique, ont permis de diminuer considérablement le nombre d’animaux dans les études de physiopathologie et d’acquérir une grande quantité de données qui ne peuvent être exploitées qu’à l’aide de la bio-informatique. De plus, la modélisation moléculaire, la pharmacocinétique et toxicocinétique in silico concourent également à cette diminution de l’expérimentation animale.
- Francelyne Marano est professeur émérite de biologie cellulaire à l’université de Paris. Elle préside le GIS FRANCOPA.
- Hubert a été directeur des risques chroniques à l’Ineris. Il est actuellement directeurde FRANCOPA et préside son équivalent européen ECOPA.
- Laure Geoffroy est ingénieur en écotoxicologie à l’Ineris et secrétaire scientifique duGISFRANCOPA.
- Hervé Juin est chercheur en nutrition animale à INRAE. Il est aussi chargé de mission sur l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques pour l’Institut.
Le GIS Francopa est une plateforme française dédiée au développement, à la validation et à la diffusion de méthodes alternatives en expérimentation animale.
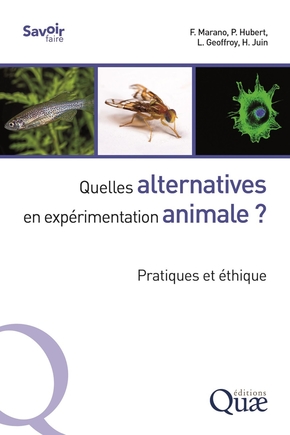
• Editeur : Éditions Quae
• Collection : Savoir faire
• Publication : 17 septembre 2020
• EAN13 Livre papier : 9782759231874
• EAN13 eBook [PDF] : 9782759231881
• EAN13 eBook [ePub] : 9782759231898
• Format (en mm) : 160 x 240
• Nombre de pages Livre papier : 186
Voir aussi notre page : INRAE, Institut responsable en matière d’expérimentation animale
