Biodiversité Temps de lecture 10 min
Impact des modes de production sur la biodiversité. Eclairages
Depuis 2021, la France envisage d’instaurer un affichage environnemental pour les produits et services afin d’informer les consommateurs sur l’impact de leurs achats. Le but est de les orienter vers des choix plus durables et d’inciter les producteurs à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Une étude menée par INRAE et Ifremer, restituée le 30 avril 2025, a exploré les effets de notre alimentation sur la biodiversité. En analysant les pratiques et les cahiers des charges de 13 labels liés à l’agriculture, l’aquaculture et la pêche, elle propose des pistes pour mieux intégrer la biodiversité dans les labels et les politiques publiques.
Publié le 31 juillet 2025

Plus que jamais, l’effondrement de la biodiversité fait consensus au sein de la communauté scientifique, tout en nous interpellant fortement. Cette situation est d’autant plus critique que l’état de l’environnement, la santé et l’alimentation sont étroitement liés — comme le souligne la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques dans son rapport 2024. Elle appelle à des transformations profondes de nos modes de vie et de production. L’agriculture, la pêche et l’aquaculture comptent parmi les activités humaines qui affectent la biodiversité des écosystèmes terrestres et aquatiques.
1 exploitation agricole sur 4 engagée dans un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine dont la garantie du respect de l’environnement.
Ces signes concernent plus de 1 100 produits en France (Source : Inao, 2023).
Quel rôle peut avoir le consommateur à l’égard de ces enjeux ? De quelle manière peut-il exercer un choix éclairé en faveur de la biodiversité, à la croisée d’une information pertinente, de ses valeurs personnelles et de ses objectifs ?
Les livrables de l'étude
Les résultats de l’étude « Impacts des modes de production labellisés sur la biodiversité » sont disponibles sous forme de 3 documents :
Ulrich C. (coord.), Lescourret F. (coord.), Le Gall O. (coord.) et al. (2025). Agriculture, aquaculture et pêche : impacts des modes de production labellisés sur la biodiversité.
- Rapport d’étude, INRAE -Ifremer (France), 582 pages.
- Synthèse du rapport d’étude, INRAE -Ifremer (France), 88 pages.
- Résumé du rapport scientifique de l'étude, INRAE - Ifremer (France), 12 pages
Voir également
- Vidéos du colloque
- Communiqué de presse
Choisir en faveur de la biodiversité
Les labels sont un levier d’action puisque leurs cahiers des charges certifient des pratiques. Ils sont actuellement au cœur de nombreux débats sur les relations entre production et consommation durables. Leur impact sur la biodiversité intéresse les acteurs publics en vue de l’affichage environnemental (loi Climat et résilience, 2021) ou pour justifier les critères des marchés publics en matière d’approvisionnement en restauration collective (loi Egalim 2018 et suivantes).
10 millions de repas pris à l’extérieur quotidiennement dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et du social, du travail (Source : SNRC, 2024).
Les repas servis en restauration collective doivent, sur une année, contenir au minimum 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % issus de l’agriculture biologique ou en conversion (Loi Egalim 2025).
Impact des labels sur la biodiversité
Quel est l’impact des modes de production labellisés, en agriculture, pêche et aquaculture (pisciculture, conchyliculture), sur la biodiversité ?
La littérature scientifique est généralement trop limitée pour conclure sur les impacts des labels sur la biodiversité, à l’exception de l’agriculture biologique et du label MSC. L’agriculture biologique présente des gains estimés autour de 30 % en richesse spécifique à l’échelle de la parcelle par rapport à l’agriculture conventionnelle. Le label MSC garantit des pratiques de bonne gestion qui visent à limiter la surexploitation des stocks de pêche. Toutefois, sa valeur ajoutée sur les autres composantes de la biodiversité (fonds marins, captures accidentelles...) est peu documentée.
13 labels étudiés
L’étude s’est centrée sur un échantillon de 13 labels représentant une diversité de produits, de statuts et de contextes de production.
Publics ou privés, de portée nationale à mondiale, généralistes ou dédiés à une filière précise, ils se rapportent à la qualité des produits, au lien au territoire, à la durabilité : Agriculture biologique, AOP/IGP, Label Rouge, HVE, écolabel Pêche durable, Demeter, Nature et progrès, Bleu-Blanc-Cœur, Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council, les tables rondes sur l’huile de palme durable (RSPO) et sur le soja responsable (RTRS) ou encore Rainforest Alliance.
Les auteurs et autrices de l’étude se sont donc intéressés à l’impact des pratiques citées dans les cahiers des charges des labels et qui affectent la biodiversité.
Ils ont identifié 8 pratiques agricoles favorables à la biodiversité avec un niveau de confiance fort : la présence dans le paysage d’éléments semi-naturels (haies, mares, bois, jachères, bandes fleuries…) et de prairies, les rotations diversifiées la réduction du travail du sol, l’absence de traitement avec des pesticide de synthèse, la fertilisation organique, l’implantation de couverts végétaux et les cultures associées. Ils ont également classé 11 pratiques favorables avec un niveau de confiance modéré, telles que la diversification des cultures ou la réduction de la taille des parcelles. Toutes les pratiques favorables à la biodiversité n’apparaissent pas. Par exemple, la lutte contre la déforestation importée, présente dans certains labels, n’a pas été abordée car elle n’était pas étudiée dans les ressources mobilisées dans cette étude.
« On considère qu’une pratique est favorable à la biodiversité avec un niveau de confiance fort lorsqu’elle a une majorité d'effets positifs sur au moins 2 groupes taxonomiques […] les plantes et les arthropodes, par exemple […] et sur 2 variables importantes de biodiversité qui sont l’abondance et la diversité des communautés », explique Françoise Lescourret, une des trois pilotes scientifiques de l’étude.
« Les labels jouent un rôle utile pour la prise en compte de la biodiversité », ponctue Olivier Le Pivert, délégué à l'appui aux politiques publiques (Ifremer). En effet, la majorité des labels étudiés en agriculture affichent des objectifs environnementaux liés à la biodiversité, qui prennent en compte au moins une pratique favorable à la biodiversité avec un niveau de confiance fort dans leur cahier des charges. Les objectifs vont de simples mentions de la protection de la biodiversité à des résultats chiffrés concernant la préservation des écosystèmes.
« Un certain nombre de prescriptions dans les cahiers des charges sont d’ailleurs plutôt des interdictions ou des restrictions mais ne précisent pas par quoi ces pratiques peuvent être remplacées alors que c’est déterminant », commente Olivier Le Gall, un des 3 pilotes scientifiques de l’étude.
Les 3 labels bio (Demeter, AB, Nature et Progrès) sont ceux qui intègrent le plus de pratiques favorables avec un niveau de confiance forte de façon ambitieuse et obligatoire.
En pêche, les cahiers des charges des labels MSC et l’Ecolabel Pêche durable présentent des préconisations proches. Celles-ci portent davantage sur les résultats à atteindre que sur les pratiques à mettre en œuvre : par exemple, il y a peu ou pas d’exclusion d’engins ou de pratiques de pêche.
Quant aux labels aquacoles, ils cernent bien les principaux risques : gestion de l’alimentation, implantation d’infrastructures d’élevage, densité des élevages, gestion des échappements. Les exigences des cahiers des charges sont très variables et souvent peu ambitieuses à propos des pratiques défavorables. Les seuils d’exigence sont davantage motivés par le bien-être animal (densité, comportement) que par la protection de la biodiversité.
Efficience des labels
Si l’étude fournit des clés d’analyse et de compréhension quant à l’impact des productions labellisées sur la biodiversité, elle met aussi en exergue les conditions d’efficacité des labels.
Cette efficacité dépend de leurs cahiers des charges : les mesures obligatoires qui structurent généralement la cohérence et l’ambition du cahier des charges, sont celles dont les effets sont mesurables sur le terrain ; les mesures identifiées comme favorables à la biodiversité qui sont peu prises en compte, gagneraient à y figurer.
Elle dépend également de leur « design » institutionnel : gouvernance, définition du cahier des charges, contrôles, suivi des audits, traçabilité des produits labellisés. Ce dernier influence l’attractivité et le niveau des exigences.
Enfin, pour être efficace, un label doit également être utilisé : viabilité économique pour les producteurs, consentement à payer des consommateurs, accès garanti à certains marchés, soutiens publics sous formes d’aides ou d’encadrement des pratiques sont autant de leviers d’action à considérer.
L’étude met aussi en évidence certaines limites : le choix de l’unité fonctionnelle la plus appropriée pour évaluer l’impact des produits sur la biodiversité (par kg de produit ou par unité de production, hectare de surface utilisée en agriculture, par exemple), les lacunes dans les connaissances sur les interactions entre pratiques ou encore sur l’intégration des impacts à une échelle paysagère, au-delà de la parcelle cultivée.
« En agriculture, l’échelle du paysage est très rarement prise en compte dans les cahiers des charges. Ce que décrivent les cahiers des charges, ce sont les conditions de production au mieux, dans l’exploitation ou sur la parcelle agricole mais pas l’organisation de l’exploitation dans le paysage ou l’organisation du paysage autour des exploitations », détaille Olivier Le Gall.
Elle soulève également des points de vigilance dont la nécessaire cohérence qui doit guider les politiques de protection de la biodiversité, les politiques agricoles et halieutiques et les politiques nutritionnelles.
Autant d’éléments à même d’irriguer une réflexion autour de l’impact des modes de production sur la biodiversité, des producteurs aux consommateurs en passant par les décideurs publics.
Une étude menée par la Direction de l’expertise scientifique collective, de la prospective et des études (DEPE) d’INRAE
Cette étude a mobilisé 29 experts scientifiques de différentes disciplines (agronomie, halieutique, écologie, biologie, hydrologie, économie, gestion, sociologie et droit), appartenant à 9 organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur français ou européens.
Elle s’appuie sur 1 205 références, dont 876 articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture.
Le cadre méthodologique des expertises scientifiques collectives et des études conduites par la DEPE a été appliqué.
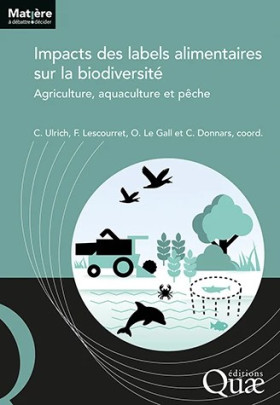
Vient de paraitre
Ulrich C., Lescourret F., Le Gall O et, Donnars C. (coordination scientifique). Impacts des labels alimentaires sur la biodiversité.
Ed. Quae (Versailles), collection Matière à débattre et à décider. Mars 2026. 140 pages.
EAN13 Livre papier : 9782759242177
