De la vache au peuplier, en passant par l’abeille et le blé, comment se décline la sélection génomique ?
Publié le 24 septembre 2021
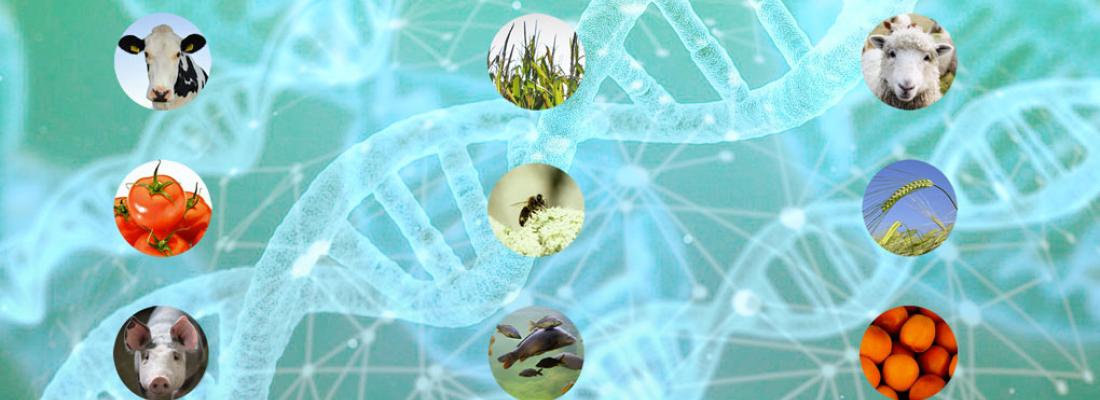
Depuis le début de l’agriculture, les animaux ou les plantes ayant les meilleures performances (allure, rendement, prolificité, quantité de lait ou de viande, longévité…) sont choisis par l’homme pour assurer la production de la génération suivante. Ainsi les performances évoluent au fur et à mesure des générations, conduisant au progrès génétique. Le XXe siècle a vu la rationalisation de ce processus avec la mise en place de schémas de sélection dont l’organisation diffère en fonction des espèces pour des raisons biologiques et socioéconomiques. Pour mettre en œuvre la sélection, il faut notamment 1/ mesurer les performances ou caractères que l’on veut sélectionner. Ces performances mesurées sur les individus sont appelées phénotypes, cela peut être par exemple la production laitière, la résistance à une maladie, une couleur de fruit etc … 2/ utiliser des méthodes statistiques pour combiner les informations disponibles : phénotypes et relations de parenté entre les individus pour pouvoir choisir objectivement les meilleurs individus en estimant leur valeur génétique.
La sélection génomique, développée au début des années 2000, valorise en plus les informations de génotypage. L’ADN des individus est extrait à partir d’une simple prise de sang pour un animal, ou d’une feuille pour un végétal. Le génotypage consiste à « lire » des milliers de marqueurs génétiques (SNP –Single Nucleotide Polymorphism) répartis sur l’ensemble du génome des individus. Dans une population de référence, les individus sont à la fois phénotypés et génotypés. On peut alors établir une équation de prédiction génomique qui fait le lien entre les informations sur l’ensemble des marqueurs et le phénotype des individus. Une fois cette relation établie, les candidats à la sélection peuvent être uniquement génotypés : on estimera alors leur valeur génétique en appliquant l’équation de prédiction. L’utilisation complémentaire du phénotypage reste bien sûr possible.
D’autres définitions utiles :
Cycle de sélection : un cycle de sélection est constitué de toutes les opérations entre la production d’individus à partir de croisements/accouplements et la production de la génération suivante. La durée du cycle de sélection est un élément clé du progrès génétique : plus le cycle est court, plus le progrès génétique par année est grand et plus les performances évoluent rapidement. Selon l’espèce, cette durée peut varier d’un an pour les volailles de chair à 20 ans pour certaines espèces d’arbres.
Intensité de sélection : dans un schéma de sélection, un certain nombre de candidats à la sélection sont évalués. Puis certains sont choisis comme reproducteurs pour constituer la génération suivante. L'intensité de sélection est d'autant plus forte que la proportion d’animaux choisis par rapport au nombre de candidats est faible. Plus l’intensité est forte, plus le progrès génétique sera élevé sur le cycle de sélection considéré.
La sélection génomique est une méthode générique qui peut être mise en œuvre pour toutes les espèces animales et végétales. Est-elle pour autant appliquée de manière identique quelle que soit l’espèce considérée ? Quels sont les arguments principaux qui incitent les sélectionneurs à adopter cette technologie ? Comment les caractéristiques biologiques et l’organisation des programmes de sélection des différentes espèces influencent-elles le choix des sélectionneurs ?
Le réseau R2D2 soutenu par le métaprogramme INRAE SELGEN s'est intéressé à différentes questions méthodologiques sur la sélection génomique. La particularité de ce réseau est de regrouper des chercheurs travaillant sur une large gamme d'espèces animales et végétales : abeille, bovins lait et bovins viande, caprins, cheval, ovins, poissons, porc, volaille, abricotier, blé, maïs, peuplier, pin maritime, plantes fourragères, pois, pommier, riz, tomate, vigne … Ainsi, 75 chercheurs d’origine très variée (départements INRAE BAP (Biologie et Amélioration des Plantes, GA (Génétique Animale), EcoDiv (Ecologie et Biodiversité) et EcoSocio (Economie et Sciences Sociales), IFREMER, CIRAD et SYSAAF), généticiens et économistes ont participé aux activités du réseau.
La comparaison entre toutes ces espèces a montré que la sélection génomique peut être mise en œuvre de manière très différente dans les programmes de sélection. Cette analyse transversale a permis de mettre en évidence trois principales logiques de mise en œuvre qui ont été appelées briques et qui peuvent éventuellement être combinées entre elles.
Brique A : Ajouter du génotypage pour améliorer la précision de la prédiction des valeurs génétiques
Dans cette « brique », l’information génomique est ajoutée à l’information connue des phénotypes pour améliorer la précision de la prédiction des valeurs génétiques. Dans ce cas, le coût des schémas de sélection augmente, mais on attend un progrès génétique plus important.
Cette stratégie est intéressante quand les performances sont difficiles à évaluer ou que leur recueil nécessite des dispositifs de phénotypage coûteux. C’est le cas des caractères à faible héritabilité, caractères dont le niveau de performance se transmet peu à la génération suivante (par exemple, pour les caractères de reproduction chez le porc ou l’aptitude à la panification du blé d’hiver). Une héritabilité faible est aussi observée pour des caractères qui dépendent fortement des conditions environnementales, comme c'est le cas, par exemple, sur le blé ou le maïs.
Cette stratégie est aussi intéressante pour les caractères létaux, qui nécessitent de sacrifier l’individu pour pouvoir être mesurés : par exemple, le rendement carcasse sur un animal. On ne peut donc pas sélectionner directement les animaux évalués sur ces caractères. En pratique, on utilise l’information issue d’animaux apparentés (par exemple des frères/sœurs) pour prédire la valeur génétique des candidats à la sélection. La sélection génomique permet d’utiliser l’information génomique de chaque candidat à la sélection et d’améliorer fortement la précision de la prédiction et donc le progrès génétique obtenu pour ce type de caractères. Cette stratégie est utilisée pour les porcs et les poissons et serait également pertinente pour certains arbres forestiers et plantes fourragères.
Brique B : Remplacer le phénotypage par du génotypage pour raccourcir les cycles de sélection ou pour augmenter l’intensité de sélection
Une première possibilité est de sélectionner les individus uniquement à partir d'une prédiction génomique, en supprimant donc toute étape de phénotypage. La durée de la sélection peut alors être très fortement réduite : il n’est pas nécessaire d’attendre de mesurer les phénotypes pour sélectionner les meilleurs individus. Cette stratégie est particulièrement efficace ou pourrait l’être sur des espèces présentant de longs cycles de sélection, comme les bovins laitiers, les arbres fruitiers et forestiers ou les plantes fourragères.
Une seconde possibilité consiste à réaliser une première étape de sélection sur la base des prédictions génomiques, ce qui permet d’écarter très tôt les candidats les moins intéressants. La sélection définitive est ensuite faite après phénotypage des individus présélectionnés. Cette procédure en deux étapes permet d’augmenter fortement le nombre de candidats à la sélection et donc l’intensité de sélection puisqu’une grande partie d’entre eux peut être éliminée précocement. Elle est mise en œuvre chez les caprins et les ovins laitiers.
Cette stratégie peut être appliquée quand la précision de la prédiction génomique est suffisamment bonne par rapport à la sélection basée sur le phénotypage. Par ailleurs, il sera toujours nécessaire de phénotyper les individus de la population de référence.
Brique C : Mieux choisir les parents pour réaliser de meilleurs croisements ou pour préserver la diversité génétique
Cette brique peut être utilisée pour mieux choisir les parents des nouveaux croisements qui seront réalisés pour générer la génération suivante. Plus les parents sont complémentaires en termes de performances, plus leur descendance a des chances d’être performante. L’information génomique permet de mieux connaître les caractéristiques génétiques des parents pour les différents caractères et donc de choisir ceux qui présentent la plus grande complémentarité. Des études sur cette application ont été réalisées sur certaines espèces de grandes cultures comme le maïs mais aussi sur les bovins laitiers.
Par ailleurs, l’information génomique permet de mieux évaluer l’apparentement entre les individus. On peut ainsi choisir les reproducteurs de façon à préserver la diversité génétique, garante du progrès génétique à long terme. Ceci est par exemple mis en œuvre chez les caprins en France.
Quelles briques ont été utilisées par les sélectionneurs ?
Historiquement, le passage à la sélection génomique s’est fait rapidement pour les espèces pour lesquelles le cycle de sélection est long et le phénotypage très coûteux. Dans ce cas, c’est principalement la brique B qui est d’abord mise en œuvre, avec un objectif de réduction des coûts de la sélection. L’exemple des bovins laitiers en est l’illustration parfaite. La brique A est mise en œuvre principalement pour des espèces pour lesquelles le coût de phénotypage est peu ou modérément élevé et le cycle de sélection assez court. L’intérêt pour cette brique augmente au fur et à mesure que le coût du génotypage diminue. Bien qu’elle soit perçue comme très intéressante, la brique C seule ne semble pas être suffisamment importante pour inciter les sélectionneurs à sauter le pas de la sélection génomique. On peut cependant s’attendre à ce qu’elle soit de plus en plus utilisée en combinaison avec les briques A et/ou B. De manière générale, après la mise en œuvre principale d’une brique qui convainc à basculer vers la sélection génomique, les schémas évoluent vers un mix de pratiques issues des différentes briques, avec des adaptations spécifiques de chaque schéma ou chaque espèce.
On peut donc dégager de grandes tendances quant à la manière de mettre en œuvre la sélection génomique, mais ce choix peut déroger à ces tendances en fonction de particularités liées aux spécificités biologiques, à l’organisation de la sélection ou au contexte économique. Par exemple, pour les arbres forestiers, la très longue durée du cycle de sélection rend a priori la brique B très intéressante, mais son intérêt pourrait être limité par la maturation sexuelle tardive et donc un impact au final limité sur la diminution de la durée totale du cycle de sélection. La brique A pourrait également être pertinente en permettant l’introduction de nouveaux caractères difficiles à mesurer.
Référence
R2D2 consortium, Fugeray-Scarbel A., Bastien C., Dupont-Nivet M., Lemarié S., 2021. Why and How to Switch to Genomic Selection: Lessons From Plant and Animal Breeding Experience. Frontiers in Genetics 12:629737. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.629737
