Agroécologie Temps de lecture 4 min
Effecteurs : subterfuge et manipulation
Publié le 04 janvier 2023
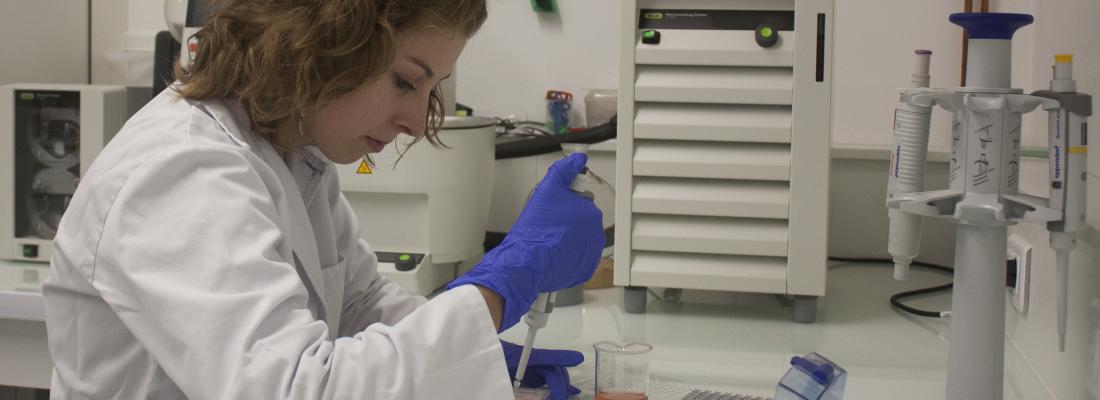
Le terme « effecteur », au sens donné ici, n’est apparu qu’au début des années 1990 avec l’identification des effecteurs de type III chez la bactérie Yersinia pestis. Néanmoins, les scientifiques étudiaient déjà les effecteurs de pathogénie depuis de nombreuses années chez les bactéries et champignons phytopathogènes. Près de 30 ans après l’introduction de ce terme, des effecteurs ont été caractérisés chez des bactéries, des champignons, des oomycètes mais aussi chez des nématodes et des virus.
Longtemps, les effecteurs ont été restreints aux seules protéines, principalement parce que, très tôt, il est apparu que certains individus d’une espèce végétale étaient capables de reconnaitre certains individus d’une espèce microbienne. Cette reconnaissance repose sur une relation gène-pour-gène, avec un gène de résistance chez la plante qui permet la détection de l’agent pathogène ayant le gène d’avirulence associé. Les connaissances évoluant, la définition évolue elle aussi au fil des découvertes et des exemples qui s’accumulent quant à la diversité de ces effecteurs. C’est ainsi que des molécules non protéiques tels que des petits ARN et des métabolites secondaires (MS, aussi appelés métabolites spécialisés) sont maintenant régulièrement considérés comme des effecteurs. Dans l’unité BIOGER (Biologie et gestion des risques en agriculture), nous étudions les 3 types d’effecteurs (protéines, petits ARN et métabolites secondaires) chez divers champignons phytopathogènes. Comme les effecteurs protéiques ont été très étudiés, notamment dans le cadre des relations gène-pour-gène, j’ai choisi de mettre en avant ici les avancées récentes concernant les MS ayant un rôle d’effecteur.
Les apports de la génomique fongique et de la transcriptomique ont permis d’identifier de nombreux clusters de gènes de biosynthèse (BGC) dont l’expression est spécifique de l’infection de la plante hôte. Par exemple, chez le champignon hémibiotrophe Colletotrichum higginsianum, ce sont 19 BGC (et donc 19 familles de MS) qui sont spécifiquement activés lors de l’infection, dont 14 le sont au cours de la phase biotrophe, quand les cellules infectées de l’hôte sont encore en vie. Cette biosynthèse spécifique de l’infection signifie que les MS correspondants ne sont pas produits au laboratoire. Pour lever ce verrou, nous avons recours à des approches de biologie synthétique, nous permettant de produire les MS spécifiques de l’infection et de déterminer leur structure chimique. Ceci permet également de cribler les bioactivités et d’étudier le mode d’action de ces effecteurs non protéiques.
Récemment, nous avons démontré que le métabolite secondaire higginsianin B produit par C. higginsianum est capable d’inhiber l’activation de la voie de défense des jasmonates ainsi que la production d’espèces réactives de l’oxygène. À l’aide de tests biochimiques, nous avons identifié le protéasome comme une des cibles de ce MS. La syringolin A, un MS bactérien, bloque également l’activité du protéasome ce qui conduit à la réouverture des stomates pour permettre aux bactéries d’entrer dans la plante. Un autre MS, la depudecin produite par le champignon Alternaria brassicicola, est un inhibiteur de la désacétylation des histones et a un impact sur l’expression des gènes de la plante. Le botrydial, produit par l’agent de la pourriture grise Botrytis cinerea, induit une réponse hypersensible qui favorise l’infection de la plante hôte par ce champignon nécrotrophe. Un autre exemple notable est le BGC Ace1 de Magnaporthe oryzae dont le MS correspondant est une cytochalasin qui bloque probablement la polymérisation de l’actine chez le riz. Cette cytochalasin est le premier exemple décrit de MS d’avirulence puisque les variétés de riz ayant le gène de résistance Pi33 sont capables de reconnaitre ce MS.
Cependant, pour la grande majorité des MS microbiens spécifiquement produits au cours de l’infection, leur structure chimique et leurs rôles dans la manipulation de l’hôte sont complètement inconnus. Leur étude est un challenge permanent mais qui permettra de combler le manque de connaissances pourtant nécessaires pour concevoir de nouvelles méthodes de lutte contre ces maladies.
