Biodiversité Temps de lecture 3 min
Forêts d’hier et de demain
Publié le 12 janvier 2018
Pour appréhender le futur des forêts, il est important de connaître et de comprendre les forêts du passé
De tout temps, la forêt a constitué un remarquable atout de développement économique. Désormais, face au réchauffement climatique, au développement démographique et grâce aux avancées scientifiques, la forêt est devenue un enjeu d’avenir de première importance. Pour appréhender le futur des forêts, il est important de connaître et de comprendre les forêts du passé.
Initialement focalisées sur le pin maritime et les usages industriels de la résine ou du bois, les recherches forestières en Aquitaine ont progressivement embrassé tout le champ des connaissances nécessaires à une gestion durable de la forêt tout en développant ses filières de valorisation.
Ce livre fait le bilan de toutes les avancées réalisées dans ce domaine depuis 50 ans. On y découvre la diversité génétique du pin maritime et son histoire, les stratégies de conservation et de création variétale, les modèles de croissance et de sylviculture, en lien avec l’évolution de la ressource en bois, la compréhension des mécanismes du fonctionnement de l’arbre et de la forêt (échanges d’eau, de minéraux, de gaz et de chaleur avec le sol et l’atmosphère), les mécanismes de résilience face aux adversités climatiques, et sanitaires (insectes, maladies), les propriétés du bois en fonction de la sylviculture et des procédés industriels de transformation et de mis en œuvre, mais aussi les relations entre forêts et sociétés.
Sous la direction de :
Michel Arbez, directeur de recherche Inra à la retraite, ancien directeur de la station de Recherches forestières de Pierroton.
Jean-Michel Carnus, ingénieur des Ponts, des eaux et des forêts, chargé de mission au département Écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques de l’Inra, campus forêt-bois de Pierroton.
Antoine Kremer, directeur de recherche, équipe Ecologie et génomique fonctionnelle à l’UMR Biogeco de Bordeaux-Aquitaine, campus forêt-bois de Pierroton.
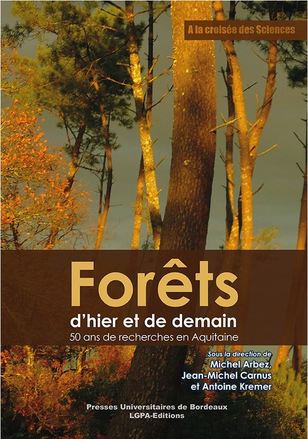
Forêts d’hier et de demain - 50 ans de recherche en Aquitaine
Extrait Le gel de janvier 1985 Une vague de froid mémorable déferle sur la France durant tout le mois de janvier 1985. L’intensité de cette vague de froid est comparable à celle du mois de février 1956, et un froid polaire concerne toutes les régions du 4 au 18 janvier. Par la suite, un flux perturbé océanique s’établit par le Sud-Ouest et c’est la fin de la vague de froid. De cet épisode, il faut retenir sa durée et son intensité, où des records de basse température ont été établis, pour toutes les stations météorologiques ouvertes depuis la guerre. Dans les Landes de Gascogne, le déroulement de la vague de froid suit le même schéma que dans le reste de la France. Des températures négatives sont enregistrées allant de -12 °C sur la côte à -22 °C à l’intérieur du massif. Moins de quinze jours après cette vague de froid, les premiers symptômes inquiétants apparaissent, non seulement dans les peuplements feuillus (gel des toutes nouvelles plantations d’eucalyptus, gélivure sur troncs de peuplier), mais aussi dans les peuplements de pins maritimes. En effet, dans certains peuplements, les pins maritimes connaissent un brunissement plus ou moins général des aiguilles. Ce n’est que le début d’un dépérissement qui va bien souvent s’avérer mortel. Un premier bilan sur le pin maritime est fait le 25 février grâce au survol du massif. Ce bilan fait état de 5 000 ha de pins définitivement condamnés et de 30 000 atteints. En 1986, le bilan passe à 60 000 ha atteints dont 30 000 ont dû être coupés (Forêt de Gascogne, 1996). La zone la plus touchée est un triangle situé au centre du massif, délimité par Morcenx, Villandraut et la forêt de Campet, la partie côtière étant la plus épargnée. C’est dans la tranche d’âge 15-30 ans que les dégâts s’avèrent les plus notables, la lande sèche semblant plus touchée que la lande humide. Fin 1987, le bilan de coupes suite au gel est monté à 45 000 ha, à cause des dégâts d’insectes (Ips Sexdentatus), qui ont suivi dans des peuplements de pin maritime situés à proximité des tas de bois laissés trop longtemps sur le terrain. Pourtant, des mesures sont adoptées dès 1985 pour exploiter le plus rapidement les peuplements touchés par le gel. Des traitements insecticides (à base de Decis) des stocks de bois bord de route sont mis en place dès le mois d’août à un niveau record (450 000 m3), et sont poursuivis (à base de Fastac) dans les années 1986 et 1987. Ils sont conduits par le corps des sapeurs-pompiers forestiers professionnels départementaux, sous la houlette technique du Service régional de la forêt et du bois. Des réseaux de surveillance, à base de pièges à phéromone, sont également mis en place. Les informations sont centralisées par l’Inra, pour mieux connaître la dynamique des populations de scolytes et améliorer le dispositif de lutte. Dès 1985 est également mis en place, par la préfecture de Région, une cellule d’observation scientifique des dégâts de froid sur le pin maritime, le phénomène « gel » apparaissant très complexe. Très vite, l’estimation des chances de survie d’un arbre apparaît délicate. Afin d’aider au diagnostic de viabilité des pins endommagés (brunissement des aiguilles sur une partie du houppier), l’Inra fait ressortir très vite que le premier facteur à prendre en compte est l’état du liber, observable directement sous l’écorce, l’état des aiguilles ne permettant pas de juger de la survie de l’arbre. Ces observations sont confirmées par le suivi de l’évolution des tissus conducteurs des pins pendant deux ans, par le Laboratoire de physiologie cellulaire végétale de l’Université de Bordeaux 1 (J.-P. Carde). Il s’avère alors que la résistance au froid du pin maritime varie fortement selon les provenances, la provenance landaise étant plus résistance que la portugaise. De même, une étude conduite au Laboratoire d’amélioration des arbres forestiers de l’Inra (Th. Boisseaux, mémoire Enitef) montre, sur un échantillonnage de peuplements bien répartis sur l’ensemble du massif, que la grande majorité des peuplements très touchés sont d’origine ibérique. Ces peuplements étaient issus des reboisements consécutifs aux incendies de la décennie 1940-1950. Au cours de ce travail, l’origine génétique des peuplements a été établie en identifiant les profils terpéniques (hydrocarbures présents dans la résine) d’échantillons de rameaux ou de plantules issus de ces peuplements, ces profils étant différents selon les provenances de pin maritime. Devant ce constat, des tests variétaux sont mis au point par l’Inra et l’Université de Bordeaux I, afin d’éviter que des semences ou des plants d’origine ibérique servent à la reconstitution du massif landais. Ce test a permis la mise en place d’une politique volontariste de certification des semences à partir de cette époque. |
