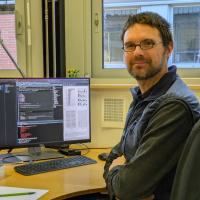
Agroécologie Temps de lecture 2 min
S’adapter et prédire, Pierre Casadebaig dessine les cultures de demain
Publié le 18 février 2025
Comment êtes-vous arrivé à INRAE ?
Pierre Casadebaig : Lors de ma formation académique en biochimie et biologie moléculaire végétale, j’ai réalisé plusieurs stages dont un dans un laboratoire INRAE à Montpellier sur l’architecture et le fonctionnement des plantes. J’ai poursuivi par une thèse qui m’a permis à la fois de découvrir l'agronomie et de travailler sur un modèle informatique pour évaluer la performance de différentes variétés de tournesol dans de multiples conditions agronomiques. Puis, j’ai réalisé un post-doc d'un an et demi au sein de l‘unité Mathématiques et informatique appliquées Toulouse (MIAT), où j'ai étudié comment l'architecture d'un couvert végétal pouvait influencer le développement des épidémies dans la parcelle, pour différentes espèces cultivées (pois, pomme de terre, vigne, igname). L’objectif principal de ce projet était de rassembler des données expérimentales, puis de formaliser et développer un modèle informatique pour aborder cette question de manière générique.
Enfin, en 2011, après un concours externe, j’ai rejoint l’unité AGIR en tant que chargé de recherche.
Quel est votre sujet de recherche ?
P.C. : Mon sujet de recherche porte sur l'analyse des interactions entre les plantes et leur environnement pour comprendre et accompagner l'adaptation des cultures et les variétés aux changements de l'agriculture. Pour cela, j’adopte une approche en deux volets.
D’une part, je mène des expérimentations en conditions contrôlées, dans des environnements où je peux ajuster certains facteurs, comme la fertilisation, les variétés ou même la teneur en eau du sol. Dans le cas du tournesol, ces expérimentations sur la plateforme Heliaphen du centre, me permettent d’étudier les processus physiologiques des plantes, tels que la vitesse de croissance des feuilles ou la quantité d'eau transpirée, afin de mieux comprendre comment les variétés réagissent aux variations environnementales.
D’autre part, je travaille sur la modélisation de ces processus. L’objectif est de traduire les mécanismes physiologiques observés en équations mathématiques afin de construire un modèle qui pourra prédire le rendement des tournesols en fonction de divers facteurs climatiques, des pratiques agricoles et des caractéristiques des variétés cultivées.
Un exemple concret de l’application de ce modèle, appelé SUNFLO, se trouve dans ma collaboration avec l’institut technique Terres Inovia. Ensemble, nous cherchons à identifier quelles variétés de tournesol sont les mieux adaptées à différents environnements.
Ce modèle sert d’outil pour fournir des conseils aux agriculteurs, afin de les aider à faire des choix de variétés pertinents selon leurs pratiques et conditions locales.
Plus récemment, je me concentre sur la modélisation de mélange d'espèces, en particulier l’association de céréales et de légumineuses. Cela nécessite l’utilisation d’approches de modélisation différentes, plus génériques, qui associent des méthodes issues de la statistique et de l'écologie. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’intérêt de cultiver deux espèces sur une même parcelle plutôt qu’une seule, et d’identifier les conditions dans lesquelles cette pratique serait la plus bénéfique. Pour ce faire, je m’appuie sur les données issues des expérimentations menées par d’autres chercheurs et laboratoires.
Avez-vous des missions complémentaires ?
P.C. : Oui, j’ai accepté le poste de directeur adjoint (aux côtés de Pierre Labarthe) du laboratoire en 2021, afin de découvrir et participer à la gestion humaine, scientifique et économique de ce collectif. Ces missions, très diverses et d'une grande richesse relationnelle, sont chronophages mais essentielles. Je souhaite aussi m'y investir pour promouvoir des pratiques de recherche menant à une science plus partagée et accessible, en un mot plus collaborative.
Et après le bureau ?

P.C. : J’ai choisi de travailler à 80 % pour libérer une journée afin de m’adonner à une activité créative en dehors de mon travail de recherche. Le jeu est de concevoir des instructions, basées sur un mélange de contrôle et de hasard, qui produisent une nouvelle œuvre à chaque exécution par une machine (art algorithmique, plus de détails sur art.casadebaig.net). Concrètement, j’utilise toujours du code informatique, mais de manière plus libre et créative !
Mini CV
- Parcours professionnel
Depuis 2011 : Chargé de recherche, UMR AGIR - INRAE Occitanie-Toulouse
2013-2014 : Chargé de recherche, université de Queensland, Saint Lucia (AUS)
2009-2011 : Chercheur contractuel, UR MIAT - INRAE Occitanie-Toulouse
2008-2009 : Chargé d'étude - Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre (Cetiom), Toulouse
- Formation
2008 : Doctorat en agronomie - Univ. Toulouse
2004 : Master Physiologie végétale - Univ. Montpellier
