Agroécologie Temps de lecture 4 min
Des leviers pour améliorer les systèmes d’élevage européens
Publié le 22 février 2017

On ne peut pas établir un bilan global de l’élevage
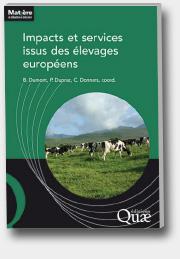
L’expertise collective a établi un inventaire des impacts et services des élevages européens, considérés dans leur ensemble, en examinant cinq grands domaines :
- les marchés,
- le travail et l’emploi,
- les intrants,
- l’environnement et le climat,
- les enjeux sociaux et culturels.
Quelques exemples d’impacts de l’élevage européen que l’on peut qualifier :
| Impacts globalement positifs | Impacts globalement négatifs |
|---|---|
| Consommation alimentaire : les produits animaux apportent près de 60% des protéines ingérés par jour | Alimentation animale : non autonomie de l’Europe en céréales et protéagineux pour les aliments concentrés |
| Production : les productions animales contribuent pour 45% à la production agricole finale en valeur | Gaz à effet de serre |
| Echanges intra- et hors- Europe dynamiques | Emetteurs d’ammoniac, précurseur de particules fines polluantes |
| Emplois : 4 millions d’actifs en Europe | Eutrophisation des eaux |
| Valorisation des prairies : 74 Mha (prairies permanentes) et 10Mha (temporaires) contre 35 Mha en céréales fourragères pour nourrir les animaux. | Zoonoses (= 75 % des maladies infectieuses humaines) |
| Recyclage du phosphore | Rejet d’antibiotiques dans l’environnement |
| Biodiversité sauvage (prairies) | |
| Richesse gastronomique |
Il n’est pas possible dans l’état actuel des connaissances de résumer tous ces effets dans un seul indicateur global d’impact, positif ou négatif. En effet, les impacts sont parfois difficiles à évaluer, ils sont multiples, très variables selon le type d’élevage, interdépendants et non-additifs. On peut cependant avancer que les impacts positifs se situent plutôt du côté de la production, des échanges commerciaux et de certaines dimensions culturelles. Les impacts négatifs concernent majoritairement l’environnement, les pressions sur les ressources (eau, énergie, aliments concentrés) et parfois, le bien-être animal.
Diminuer la consommation de produits animaux présenterait un intérêt environnemental
Des démarches de modélisation explorent les interactions qui existent entre les différents impacts et services de l’élevage. En effet, l’augmentation de la fourniture d’un service est souvent contrebalancée par la diminution d’un autre, par exemple production/environnement. Ces relations entre les services ne sont pas forcément linéaires, d’où une certaine complexité qui incite à se méfier des raisonnements simplistes. Avec leurs hypothèses et leurs limites propres, les modélisations permettent d’évaluer des scénarios prospectifs. Ceux-ci s’accordent sur l’intérêt environnemental d’une diminution de la consommation des produits animaux, couplée à la limitation de l’élevage des ruminants aux surfaces en herbe et à une meilleure valorisation des coproduits de cultures dans l’alimentation animale.
Supprimer l’élevage conduirait à une perte de services environnementaux
L’expertise souligne d’autre part qu’une suppression totale de l’élevage se traduirait, tant en Europe que dans le monde, par la perte de services environnementaux tels que : la fertilisation organique des terres, le recyclage des sous-produits des cultures, l’entretien des prairies et autres pâturages riches en biodiversité.
Des leviers différents pour améliorer les différents types d’élevage en Europe
L’expertise scientifique identifie des leviers d’amélioration pour chacun des trois grands types d’élevage européen qu’elle a défini (lire l'article) :
- Territoires denses en animaux et peu herbagers : ces élevages sont très productifs, compétitifs, mais sensibles aux fluctuations du marché et impactants pour l’environnement. L’amélioration de leurs performances consiste à limiter les pollutions et les intrants : pour les monogastriques (porcs et volailles), il s’agit d’améliorer l’efficience de la conversion alimentaire par la génétique, d’optimiser l’aménagement des bâtiments (normes HQE, lavage d’air, bien-être…), le recyclage des effluents (séchage, méthanisation…), la qualité sanitaire des troupeaux, etc.
- Territoires herbagers : ces territoires valorisent les ressources locales sans chercher à maximiser la production. Ils misent sur la qualité de leurs produits et limitent la pression sur l’environnement. L’équilibre entre performances productives et environnementales se joue dans la conduite des prairies et l’organisation des filières pour la valorisation et la différenciation des produits. Lire aussi l'article : "Comment peut-on optimiser la prairie?".
- Territoires où cohabitent cultures et élevage : l’idéal-type de ces territoires est la polyculture-élevage qui valorise les complémentarités entre les deux secteurs. Cependant, l’élevage a été souvent concurrencé et évincé par les cultures, plus rentables et mieux soutenues par les aides. Les leviers visent à recoupler cultures et élevage, insérer des légumineuses et des cultures intermédiaires dans les rotations pour l’autonomie alimentaire des élevages. Des ruminants ou des volailles peuvent aussi être introduits dans les vergers et les rizières.
L’expertise collective menée par INRAE a impliqué 27 chercheurs, dont un tiers hors Inra. Elle se base sur une large synthèse bibliographique internationale, environ 2450 références récentes. Elle vise à appréhender les élevages européens globalement, avec ses différents rôles, impacts, services et leurs interactions. L’intention est d’objectiver les débats et d’éviter les biais méthodologiques. Ainsi, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre (GES) donnent lieu à des interprétations différentes selon qu’on les rapporte au kg produit ou bien à l’hectare, le premier indicateur étant plus favorable aux territoires à forte densité de production animale, le second aux territoires plus fortement herbagers. Lire l'article et voir le colloque de restitution de l'expertise.
