Agroécologie Temps de lecture 5 min
Culture, prairie ou forêt : la pollution métallique évolue différemment dans les sols
Publié le 30 août 2021
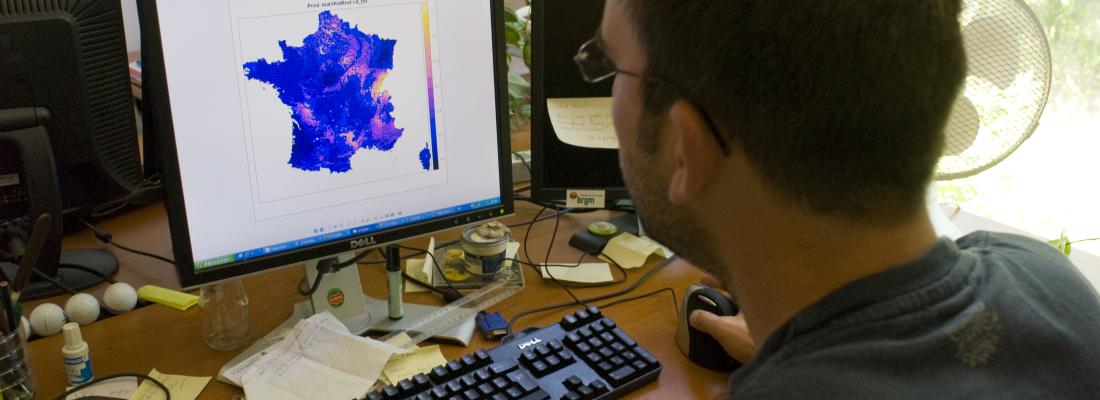
Les contaminations, locales ou diffuses par les micropolluants organiques et les éléments traces métalliques constituent une menace pour les sols et la santé publique.
Dans le Nord de la France, des scientifiques se sont intéressés à la pollution de trois terrains situés à égale distance (environ 3 km) d’un ancien complexe métallurgique : deux sols agricoles dont l’utilisation est restée inchangée depuis un siècle – une prairie permanente et une culture conventionnelle - et un sol de forêt (hêtre et pin). Ils ont plus particulièrement comparé la répartition dans ces sols de deux éléments, le plomb (Pb) et le zinc (Zn), car ce sont les polluants majoritaires et ils présentent des aptitudes de transfert contrastées.
Le complexe métallurgique de Mortagne-du-Nord en quelques mots
Situé à la confluence de la Scarpe et de l'Escaut, le complexe métallurgique de Mortagne-du-Nord (59) comprenait une fonderie de zinc, active de de 1901 à 1963 et une unité de production d'acide sulfurique, en activité de 1924 à 1968. Une unité de production de plomb a également fonctionné pendant une dizaine d'années.
Au milieu des années 1920, ce complexe fournissait 31 % de la production de zinc de la France, soit une production annuelle d'environ 25 000 tonnes et une production totale, entre 1901 et 1963, estimée à 390 × 104 tonnes.
L’activité de ce complexe a engendré une pollution importante en métaux (dont en zinc et plomb), présente encore aujourd’hui sur l’ancien terrain industriel sous forme de déchets enfouis (env. 20 000 tonnes) et dans les sols et les sédiments des alentours du fait des retombées atmosphériques de poussières et de fumées (env. 12 000 tonnes).
Culture ou prairie : des quantités de polluants identiques, mais une répartition différente
Les quantités d’éléments métalliques d’origine industrielle mesurées sur un mètre de profondeur, sont comparables dans les deux sols : 17,3 et 19,1 g Pb par m3 ; 44,6 et 46,3 g Zn par m3 sous culture ou prairie, respectivement. Ces quantités s’additionnent au contenu naturel de ces sols en métaux (14,5 g Pb par m3 et 45 g Zn par m3). Ainsi, à une distance de 3 km de l’ancienne usine, les quantités de Zn et de Pb dans les deux sols étudiés sont constituées pour moitié environ de métaux issus de l’activité métallurgique. Cette proportion augmente dans les sols lorsque l’on se rapproche de l’ancienne usine.
Par contre, leur répartition verticale est très différente. Leurs concentrations diminuent en fonction de la profondeur du sol mais, sous prairie, elles sont plus faibles en surface. Le plomb est présent à de plus grandes profondeurs dans le sol de prairie, comparé au sol de culture.
Une répartition verticale des polluants influencée par l’activité biologique des sols
Les scientifiques ont étudié la distribution du Zn, du Pb et de la matière organique ainsi que les caractéristiques morphologiques des sols. En surface des deux sols, des quantités importantes de Zn et Pb se retrouvent dans des agrégats de très petite taille (2-20 µm). Ceux-ci résultent surtout de l’activité microbienne et racinaire des sols. Cependant, dans le sol sous prairie, une proportion importante de ces métaux est également mise en évidence dans des agrégats plus grands (50-100 µm) et jusqu’à 80 cm de profondeur. Ces derniers sont caractéristiques de l’activité de la faune du sol, notamment des vers de terre, plus nombreux sous prairie (environ 400 individus par m2) que dans le sol cultivé (environ 50 individus par m2).
Différents mécanismes d’incorporation des métaux dans les sols
Dans les deux sols, le Zn migre dans la solution du sol sous forme d’ions libres (Zn2+) ; il est intercepté et retenu en profondeur par des constituants spécifiques chargés négativement (argiles, oxydes de fer ou de manganèse). De plus, dans le sol sous prairie, les vers de terre ingèrent, en surface, la terre qui contient des métaux ; ils rejettent en profondeur leurs déjections et contribuent ainsi à incorporer le Pb et le Zn en profondeur, et donc, à diminuer leurs teneurs en surface.
Pour la forêt, davantage de plomb et moins de zinc
Dans le sol de forêt, la quantité de Pb attribuée à la pollution est supérieure à celle des sols agricoles (environ 25 g par m3). Par contre, la quantité totale de Zn ne représente qu’environ 20 % de celle des sols agricoles. La raison : en forêt, la partie la plus élevée des arbres ou canopée, qui est soumise aux vents dominants, filtre l’atmosphère et concentre les éléments métalliques. Ceux-ci arrivent au sol à la faveur des pluies ou de la chute des feuilles. Mais dans les conditions acides des sols de forêt, le Zn est entraîné par les eaux pluviales vers la nappe phréatique, contrairement au Pb, peu mobile, qui reste en surface.
Mesurer le poids du passé pour préparer l’avenir
En 2003, soit 40 ans après que l’usine ait cessé son activité métallurgique, dans le sol de culture, 92 % du Pb et 60 % de Zn apportés aux sols sous forme de poussières sont encore présents en surface et susceptibles d’être mobilisés par les pratiques agricoles. Dans le sol sous prairie, 80 % du Pb et seulement 40 % du Zn se retrouvent encore en surface. Enfin, sous forêt, seul 20 % du Zn subsiste, le reste ayant été entraîné vers la nappe phréatique.
Une meilleure compréhension de la dynamique des polluants métalliques dans les sols passe par une stratégie d’échantillonnage adaptée à la finalité de la question de recherche explorée, avec par exemple, des prélèvements d’échantillons par couche de sol (ou horizon pédologique) ou par incréments systématiques afin d’obtenir les informations pertinentes à l’échelle étudiée et par la prise en compte de l’occupation et plus largement de la gestion des sols, selon qu’ils sont dévolus à un usage agricole ou forestier.
Le rapport Zn/Pb, un indicateur puissant de la dynamique des éléments métalliques dans les sols
Récemment, les chercheurs ont proposé d’utiliser comme indicateur de la dynamique des éléments métalliques dans les sols, le rapport des concentrations en éléments mobiles et peu mobiles dans l’horizon de surface (0-30 cm de profondeur).
En effet, les rapports de concentration Zn/Pb dans la couche superficielle des sols de cultures, de prairies et de forêts étaient remarquablement contrastés (3, 1,5 et 0.5, respectivement) indépendamment de la distance à la source d'émission. A l’inverse, les concentrations totales de Zn et de Pb considérées séparément, n'étaient que légèrement discriminantes.
Le rapport Zn/Pb constitue un indicateur puissant, rapide d’accès et facile d’utilisation qui permet de mettre clairement en évidence le rôle du mode de gestion des sols sur la dynamique divergente de ces métaux dans le temps et, par conséquent, sur les interactions entre les polluants et les sols dans différentes conditions de leur utilisation. Une approche particulièrement bien adaptée en cas de pollution métallique historique, découlant notamment de l’activité industrielle, répandue dans le monde entier au cours des siècles derniers.
F. van Oort et al. 2020. Zn/Pb concentration ratios emphasize spatio-temporal airborne metal dynamics in soils under different land use. Water Air Soil Pollution 231: 190.
C. Fernandez et al. 2010. Fate of airborne metal pollution in soils as related to agricultural management: 2. Assessing the role of biological activity in micro-scale Zn and Pb distributions in A, B and C horizons. European Journal of Soil Science 61: 514.
P. Cambier, C. Schwartz et F. van Oort (coord.). 2009. Contaminations métalliques des agrosystèmes et écosystèmes péri-urbains. (Éditions Quae, Versailles), 308 pages.
