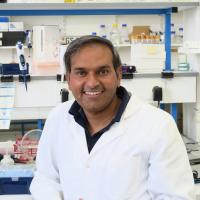
Agroécologie Temps de lecture 5 min
Rajeev Kumar, au cœur de la méiose
Publié le 06 juillet 2021
Sourire aux lèvres, Rajeev Kumar parle avec brio de la méiose. Ce sujet rythme son quotidien de scientifique depuis de nombreuses années et plus encore depuis qu’il a été recruté en 2014 à l’Institut Jean-Pierre Bourgin (INRAE, AgroParisTech, ELR CNRS). Un parcours à découvrir en quelques étapes clés.
Sur les routes d’Europe
Dès 2001, titulaire d’un master en biochimie obtenu à l’Institut indien de recherche agricole, Rajeev Kumar quitte l’Inde pour l’Allemagne. C’est à Aix-la-Chapelle, à l’Université technique de Rhénanie-Westphalie qu’il va préparer un doctorat en biologie. Pendant quatre ans, il va ainsi s'intéresser à la biosynthèse de la vitamine E dans les graines de colza.
Diplômes en poche R. Kumar choisit de poursuivre sa carrière en France. Il va travailler successivement à l’Institut Pasteur (Paris), à l’Institut de génétique humaine (Montpellier) et enfin, à l’Institut Curie (Paris).
Ce seront presque 10 années au cours desquelles R. Kumar va se forger une expérience et un savoir-faire des plus solides dans les domaines de la génétique moléculaire, de la biologie cellulaire et de la biochimie autour de projets en lien avec la réparation de l'ADN et la recombinaison homologue sur des organismes allant des bactéries aux mammifères en passant par les levures. Il obtient ainsi de nombreux résultats qu’il publie dans des journaux internationaux de forte renommée.
Méiose et régulation des crossing-over
En 2014, fort de son expérience, Rajeev Kumar passe avec succès les concours de recrutement de l’Institut et intègre, en qualité de Chargé de recherche, l’équipe de Raphaël Mercier « Mécanismes de la méiose et apomixie » au sein de l’Institut Jean-Pierre Bourgin. Au cœur de cette très grande unité consacrée aux plantes et à leurs produits, qui compte 28 équipes de recherche et pas moins de 300 personnes, Rajeev a progressivement fait son trou et gagné en indépendance.
La méiose est un type particulier de division cellulaire qui permet de générer des cellules sexuelles, les gamètes, chez tous les êtres vivants – animaux, plantes, champignons… - qui se reproduisent sexuellement.
Elle consiste en deux divisions cellulaires successives à la suite desquelles chacune des quatre cellules filles (à l’origine des futurs gamètes) n’emporte qu’une moitié des chromosomes du parent qui les produit. Juste avant la première division, les chromosomes d'une même paire s’apparient, certaines parties s’entrecroisent, c’est alors que des fragments de matériel génétique peuvent être échangés entre les chromosomes. Ces phénomènes naturels, appelés crossing-over, contribuent au mélange de l’information génétique à l’échelle de l’individu et de l’espèce. Ils ont aussi un rôle mécanique puisqu’ils sont indispensables à la distribution correcte des chromosomes.
Chez les plantes cultivées, il peut être intéressant d’exploiter ce brassage génétique afin de réunir des caractères d’intérêt agronomique essentiels au sein de nouvelles variétés ou d’obtenir des graines strictement identiques à la plante mère.
Aujourd’hui, à la tête d’une petite équipe de quatre personnes, dont un étudiant en thèse et un chercheur post-doctoral, R. Kumar partage son temps entre la paillasse, la rédaction des projets ou d’articles scientifiques et l’encadrement. Pas de quoi chômer tandis qu’il cultive les partenariats – et notamment avec R. Mercier parti outre-Rhin au service de ses nombreux projets.
Les plantes modèles, une opportunité pour comprendre l'hérédité
Les années passent et Rajeev reste intangible : il se consacre, encore et toujours, à la méiose dont il explore les mécanismes à l’aide de la plante modèle Arabidopsis thaliana, plus connue sous le nom d’Arabette des dames.
La recombinaison homologue joue un rôle central dans la réparation des cassures double brin de l'ADN, qu'elles surviennent accidentellement dans les cellules mitotiques ou de manière programmée lors de la méiose.
Les crossing-over (CO) résultant de la réparation des cassures méiotiques sont essentiels pour une ségrégation chromosomique correcte et augmentent la diversité génétique de la descendance. Cependant, les mécanismes qui régulent la formation des CO restent pour une grande part, inconnus.
Les travaux de R. Kumar et ses collègues ont révélé l'existence d'au moins trois mécanismes de limitation des CO méiotiques dont l’un implique la protéine FIDGETIN-Like-1 ou FIGL1.
Conservée des plantes aux humains, FIGL1 intervient dans la régulation des premières étapes de la réparation de l’ADN.
Ils ont ensuite permis d’identifier la protéine FIDGETIN-LIKE-1 INTERACTING PROTEIN (FLIP) et de montrer que FLIP et FIGL1 forment un complexe protéique, également conservé d'A. thaliana à l'homme, qui régulerait l'étape cruciale de l'échange de brin d’ADN au cours de la recombinaison homologue.
Rajeev et ses collègues ont également mis en évidence les effets antagonistes des protéines BRCA2 et FIGL1 sur deux enzymes, les recombinases RAD51 et DMC1, essentiels pour que la réparation de l’ADN à la faveur de la recombinaison homologue se fasse précisément.
Patiemment, au fils des années et de ses projets, Rajeev décortique les éléments clés et le fonctionnement de la machinerie méiotique. Dans les couloirs d’INRAE, recherche fondamentale et recherche finalisée se croisent là sur l’autel de la sélection variétale des plantes face aux grands enjeux de demain.
La Covid a un peu ralenti les choses ou, disons autrement, incité à les voir sous un autre angle. Rajeev a ainsi pu se consacrer pleinement à la rédaction de ses articles scientifiques ; il a également apprécié de passer beaucoup de temps à discuter avec ses étudiants. Pour eux, cet intermède un peu forcé leur a finalement permis de bien préparer leur sujet pour mieux le commencer dès lors que l’accès aux laboratoires est redevenu possible.
Mais tout cela semble déjà loin ou presque, Rajeev aujourd’hui prépare son Habilitation à diriger des recherches (HDR). Le graal ou presque puisque cette qualification « sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs ». Une perspective que Rajeev envisage avec la sérénité du chercheur bien installé dans son quotidien professionnel comme personnel et qui augure d’un futur de qualité.
44 ans
Depuis 2013 Chargé de recherche INRAE
2012-2014 Stage post-doctoral Institut Curie, Paris
2007-2012 Stage post-doctoral Institut Génétique humaine (CNRS), Montpellier - Bourse AXA (mars 2011 – septembre 2012)
2006-2007 Stage post-doctoral Institut Pasteur, Paris - Bourse Programme Egide (2006)
2005 Doctorat de biologie, Université technique de Rhénanie-Westphalie (DE).
