Agroécologie Temps de lecture 4 min
Réussir l'implantation des cultures
Publié le 08 janvier 2020

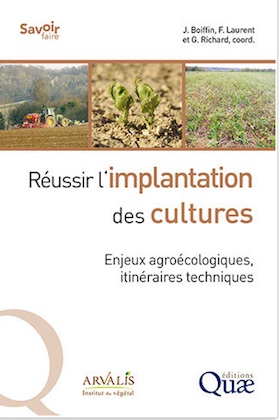
L’implantation des cultures peut se définir comme l’ensemble des processus et des actions aboutissant à l’installation d’un peuplement végétal cultivé. C’est une phase critique du cycle cultural, en raison des risques de mortalité des plantes, et un maillon crucial de l’itinéraire technique qui engage des charges d’intrants, de main-d’œuvre et de mécanisation importantes. Elle a un fort impact sur les risques de ruissellement, d’érosion et de nuisances associées, et sur la gestion des adventices. Pour l’agriculteur, les décisions techniques relatives à l’implantation des cultures portent sur de multiples opérations, avec pour chacune d’elles une large gamme d’options. Certaines de ces décisions sont liées à la structure et à l’organisation du système de production, d’autres sont des adaptations en temps réel aux conditions climatiques.
Aujourd’hui, l’implantation des cultures est affectée par de multiples évolutions – simplification du travail du sol, complexification des couverts végétaux et des successions culturales, restriction des traitements phytosanitaires, déplacement des périodes de semis, agrandissement des exploitations, innovation dans les agroéquipements –, d’où une demande particulièrement forte de références, de conseil et d’accompagnement techniques dans ce domaine.
Coordination éditoriale
Directeur de recherche honoraire à l’Inra, Jean Boiffin a été chef du département d’agronomie (1993-1997), directeur scientifique en charge des relations entre agriculture et environnement (1998-2005).
François Laurent est directeur Recherche et Développement d’Arvalis - Institut du végétal, après avoir été responsable des activités portant sur l’agronomie, l’économie, l’environnement et les systèmes de production (2006-2019).
Guy Richard est directeur de recherche à l’Inra, délégué à l’Expertise, à la Prospective et aux Études de l’Inra, après avoir été chef du département Environnement et Agronomie (2010-2018).
Réussir l’implantation des cultures
Enjeux agroécologiques, itinéraires techniques
Co-édition Quae et Arvalis – coll. Savoir faire, 440 pages, 3 janvier 2020 – 40 euros
L’expérimentation numérique et l’évaluation multicritère font désormais partie de la panoplie des outils disponibles pour assurer le renouvellement des références techniques en agronomie, en complément des approches traditionnelles basées sur l’expérimentation et l’enquête au champ, que ce soit en amont, pour mieux cibler les expérimentations et les enquêtes à mettre en œuvre, ou en aval, pour faciliter l’extension et la valorisation de leurs résultats.
S’agissant de l’implantation des cultures, leur apport est particulièrement intéressant. Grâce à l’expérimentation numérique, il est notamment possible de prendre en compte la variabilité des conditions climatiques et sa très forte interaction avec les différentes modalités de travail du sol, de semis et des autres maillons de l’itinéraire d’implantation. L’évaluation multicritère peut, quant à elle, constituer un guide de réflexion précieux, face à la diversité et au caractère potentiellement divergent des performances qui sont à prendre en compte pour évaluer la réussite de l’implantation des cultures. La multiplicité des impacts environnementaux, l’importance des aspects d’organisation du travail sont en effet des spécificités de l’implantation des cultures par rapport à d’autres catégories d’interventions culturales.
Au-delà de la « preuve de concept » qu’apportent les exemples donnés dans ce chapitre, le potentiel d’utilisation de ces démarches en appui à l’acquisition et à la valorisation de références techniques reste très largement sous-exploité, même si on s’en tient aux connaissances actuellement disponibles. Ces méthodes seraient très utiles, par exemple, pour préparer de façon exhaustive, pour les différentes cultures, l’adaptation des itinéraires d’implantation au changement climatique ou pour donner leur pleine opérationnalité aux référentiels sur la simplification du travail du sol, en les complétant sur l’aspect crucial de la gestion des adventices. Enfin, elles permettraient de mettre au point et/ou de valoriser les références techniques à des échelles spatio-temporelles inédites, inaccessibles aux démarches traditionnelles, et que rendent pourtant indispensables les enjeux environnementaux.
Le développement de ces deux démarches amène à envisager une répartition des tâches et une coordination améliorées entre les différents niveaux d’organisation du système de recherche et développement. En effet, leur extension à des thèmes non encore traités semble particulièrement correspondre au rôle des organismes nationaux de recherche et développement, tels que les instituts et les centres techniques agricoles, alors que leur utilisation en routine peut considérablement accroître l’efficacité du travail des organismes régionaux. Pour la recherche en agronomie et en environnement, la mise en œuvre de ces approches ouvre des perspectives stimulantes car elle permet d’identifier les besoins non couverts en matière de modélisation et d’évaluation, tout en constituant un cadre d’intégration et de valorisation privilégié pour les connaissances acquises.
