Agroécologie Temps de lecture 2 min
OPTIMA : un projet participatif sur l’adaptation des plantes à leur environnement
Publié le 03 décembre 2018
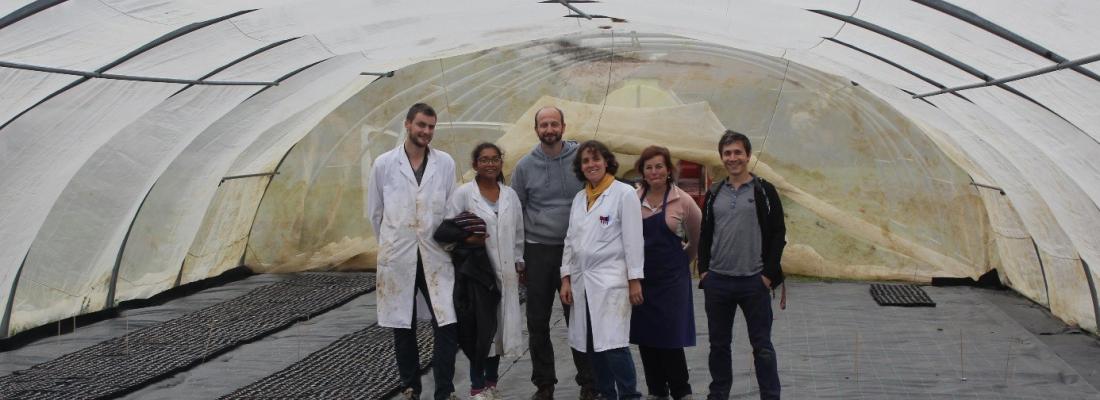
On trouve dans la littérature scientifique de très nombreuses recherches sur les capacités d’adaptation des plantes à un environnement changeant. Les stratégies employées par les plantes pour répondre à un changement environnemental sont au nombre de trois : la migration, la plasticité phénotypique ou la sélection génétique. Mais les études menées se sont essentiellement intéressées aux variations environnementales d’un point de vue climatique. Or, l’environnement de la plante est beaucoup plus complexe. Il est aussi composé du sol et de son microbiote.
C’est à l’ensemble de ces composantes écologiques qu’a décidé de s’intéresser une équipe du Laboratoire Interactions Plantes-Microorganismes (INRAE-CNRS) en prenant l’exemple de la plante Arabidopsis thaliana, plante modèle en biologie moléculaire mais avant tout une plante sauvage présente dans toute la zone identifiée. En effet, à partir de missions de terrain dans cette région, l’équipe du LIPM a observé qu’A. thaliana pouvait vivre dans des habitats très contrastés (prairies permanentes, murs, fossés, champs cultivées, parking…) et s’est posée les questions suivantes : à quelle composante écologique est adaptée A. thaliana ? et quelles sont les gènes permettant cette adaptation ?
L’objectif principal du projet OPTIMA est donc d’établir une carte génomique de l’adaptation locale d’Arabidopsis thaliana au climat, aux propriétés agronomiques du sol et au microbiote du sol. Financé par le labex TULIP, ce projet doté de 88 000 euros est actuellement en cours et s’étendra sur deux années.
Inspirés d’expériences passées et afin d’obtenir une grande variété de données, ils ont eu l’idée de lancer un projet participatif pour mener à bien ce projet, en faisant appel à des particuliers ayant un jardin. Ce type d’expérience est complexe car les lieux d’expérimentations sont multipliés mais les résultats potentiels sont très intéressants.
Concrètement, pour réaliser cette expérience, 168 populations sauvages de cette plante ont été récoltées. Toutes ces populations ont été caractérisées pour leur environnement climatique, les propriétés agronomiques du sol, le microbiote du sol mais aussi au niveau de leur génome. Trois lignées de chaque population ont été semées puis transplantées au mois de novembre dans des environnements différents (cour gravillonnée, potager, prairie permanente, verger…), chez des particuliers volontaires (45 au total). Ceux-ci, parmi lesquelles figure un établissement scolaire et le Conservatoire Botanique de Bagnères-de-Bigorre, devront photographier régulièrement les plantes pour estimer la survie des plantes au cours de l’hiver mais aussi la vitesse de croissance de celles qui auront survécu. Au total ce ne sont pas moins de 56 parcelles qui sont en cours d’utilisation, couvrant non seulement l’entière étendue géographique des 168 populations, mais aussi d’autres régions géographiques.
Les résultats issus de ce projet collaboratif sont attendus d’ici l’été 2019 et devrait nous en apprendre plus sur l’adaptation des plantes sauvages aux changements globaux en cours.
