Société et territoires Temps de lecture 2 min
24es controverses européennes à Bergerac - Agriculture & alimentation : Mais que fabriquent les prospectives ?
Publié le 11 juillet 2018

Cap sur la Dordogne
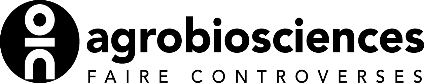
Pour les habitués des Controverses européennes, cette annonce sonne comme une mini révolution. Nouveau lieu, après 23 années passées à Marciac, et dates avancées. Qu’ils se rassurent, l’organisation trouvera là un second souffle et l’esprit demeurera inchangé : deux jours de réflexion collective où, ainsi que le disait son fondateur Jean-Claude Flamant, loin d’un colloque d’exposés des idées, il s’agit de débats ouverts où l’idée s’expose, sans crainte des dissensus et des pas de côté.
Les Controverses européennes, en quelques mots…
Organisées chaque année en juillet, les Controverses européennes ont pour originalité de mettre en débat le devenir de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux comme nulle part ailleurs en Europe. S’appuyant sur un dispositif original de débat garantissant l’expression de tous, chaque édition convie experts de renom, agriculteurs, élus, représentants de la société civile, enseignants à instruire collectivement un sujet (« Productions, marchés, consommation. Pourquoi prôner la coexistence ? » ; « Quels mondes construisent les normes ? »). Au fil des ans, cette manifestation s’est affirmée à l’échelle européenne comme un « laboratoire d’idées » où s’élabore une intelligence collective. Une singularité qui lui permet d’aborder les sujets les plus complexes et controversés.
Le sujet 2018
Nous sommes nombreux à pointer une « panne d’avenir » face aux incertitudes et à la complexité croissante de notre monde. Et pourtant, scénarios et autres prospectives semblent se multiplier, ici pour 2050, ailleurs pour 2030 ou 2100. Serait-ce que ces récits de futurs possibles sont inaudibles ? Qui les élabore et comment ? Qui s’en empare et pour quoi faire ? A quels horizons sont-ils pertinents ? Quelles controverses les traversent ?
Parmi les sujets proposés : Une agriculture zéro phyto, mais pour quand exactement ? Alimentation et science-fiction. Pays méditerranéens : après le printemps, les conjectures. Que penser des prospectives européennes ?
Autant de questions qui, à travers interventions, débats, forums et tables rondes, seront explorés collectivement par 250 participants issus de tous horizons.
Une troisième journée (12 juillet 2018) est exceptionnellement consacrée à deux cas exploratoires de l’agriculture au futur :
- « Impacts sociaux et économiques du numérique et de la robotique » (Matin)
Les technologies du numérique bouleversent d’ores et déjà l’écosystème agricole : métiers, organisations professionnelles, recherches et innovations, enseignement… En rassemblant différents points de vue et en mettant en débat les premières études sérieuses sur le sujet, il s’agit d’éclairer les acteurs sur les évolutions en cours.
- « Agroécologie : quelles coopérations scientifiques entre Métropole et Outre-mer? » (Après-midi)
Face au fort sentiment d’isolement des agriculteurs des Outre-mer engagés dans l’agroécologie, comment recréer une dynamique avec la recherche métropolitaine ? Comment opérer des connexions directes entre les projets de ces producteurs et les acteurs des laboratoires des différents Instituts concernés (Cirad, Cnrs, Inra, Ird…) ?
