Société et territoires Temps de lecture 3 min
Des choses de la nature et de leurs droits
Publié le 03 décembre 2020

Le droit de l’environnement est souvent perçu comme un instrument de marchandisation de la nature. Sarah Vanuxem en expose ici une autre vision : une conception « a-moderne », qui ne repose pas sur la division entre des choses-objets et des personnes-sujets. Colonne vertébrale de notre droit moderne, cette division n’est peut-être pas sans rapport avec la dégradation des milieux naturels. Le pari de l’auteure est d’amener le droit de l’environnement par-delà les objets et les sujets de droit, par-delà la conception juridique occidentale moderne. S’appuyant sur les travaux de Philippe Descola et, en particulier, sur l’analogisme comme alternative à la modernité ou au naturalisme, et sur certains des principes de l’ancien droit, elle précise ses réflexions en étudiant l’obligation réelle environnementale, la notion de service écologique, le principe de solidarité écologique, la compensation écologique ou bien encore la réparation du préjudice écologique.
Cet ouvrage s’adresse autant aux juristes, de l’environnement notamment, qu’à tout chercheur ou étudiant des sciences du vivant. Sa lecture interpellera aussi toute personne intéressée par les évolutions actuelles de nos sociétés sur les questions environnementales.
Sarah Vanuxem est maîtresse de conférences à la faculté de droit de l’Université Côte d’Azur. Ses recherches se situent à la croisée du droit des biens et du droit de l’environnement, avec des incursions en philosophie environnementale, en anthropologie de la nature et en histoire du droit
Editions Quae – coll. Sciences en Questions – 116 pages, décembre 2020 – 12,50 euros
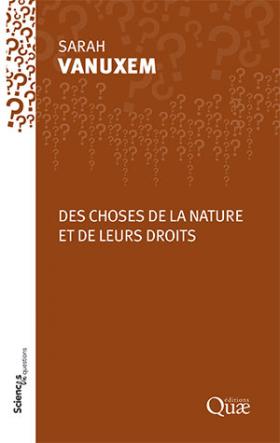
EXTRAITS
il est possible de reconnaître des droits aux choses de la nature et, simultanément, de les faire échapper à la condition d’objets
1. Pour reconnaître des droits aux animaux, végétaux ou minéraux, ne serait-il pas possible de procéder autrement que par la voie de la personnification entendue au sens occidental moderne d’une représentation ? La réponse que j’apporterai ici est positive : oui, il est possible de reconnaître des droits aux choses de la nature et, simultanément, de les faire échapper à la condition d’objets, sans procéder à leur personnification ou représentation, tout simplement parce qu’il est possible de leur reconnaître d’emblée des droits, sans passer par l’intermédiation d’humains qui seraient habilités à parler en leur nom. La position que je voudrais défendre est que cette solution, loin d’être incongrue ou parfaitement hétérodoxe, a été employée pendant longtemps, ici même en Occident, que dans une certaine mesure, elle l’est encore aujourd’hui, et que nous pourrions aller plus loin encore en réinvestissant le droit des servitudes. Non contente de nous ouvrir au mouvement contemporain des communs, une reprise de ce droit devrait nous permettre de renouveler l’approche qui est généralement faite des communs fonciers à partir de la notion de ressources naturelles. Mieux, les servitudes pourraient représenter ce pivot à partir duquel faire basculer notre conception occidentale moderne, et relire nombre de dispositions du droit émergent de l’environnement.
2.Au regard des développements antérieurs relatifs aux servitudes, il me semble que l’obligation réelle environnementale peut être présentée comme reposant sur une multitude de relations entre des choses, des personnes, des choses et des personnes. En effet, l’obligation réelle environnementale est cette obligation qu’un propriétaire s’engage à exécuter en un fonds de terre au bénéfice de la Terre, de la biosphère ou de la biodiversité. Elle résulte implicitement d’un acte unilatéral du propriétaire foncier qui choisit d’affecter le fonds de terre considéré à la planète ou à un milieu dit naturel. C’est dire que l’obligation réelle environnementale pourrait être la partie visible d’un dispositif supposant l’existence d’une servitude prédiale et, plus précisément, d’une servitude analogue aux servitudes dites d’utilité publique. Car cette servitude relierait une chose : le fonds de terre au sein duquel l’obligation doit être exécutée, à la chose de la Terre, de la biosphère ou de la biodiversité. Dans la mesure où le propriétaire foncier doit contracter avec un tiers pour l’exécution de l’obligation réelle, il est, en plus, créé une relation entre deux personnes : celle du propriétaire foncier, débitrice de l’obligation, d’une part, et celle du tiers-cocontractant, exécutrice de l’obligation, d’autre part. Dès lors qu’il est tenu d’exécuter son obligation dans le fonds grevé indépendamment de l’identité du propriétaire foncier (l’obligation réelle suivant le fonds en quelque main qu’il passe), le cocontractant apparaît détenir un droit réel (en ce sens, Denizot, 2016). Il est ainsi établi un rapport entre la personne du cocontractant et la chose du fonds de terre. Dans la mesure aussi où le cocontractant doit être une personne morale agissant pour l’environnement, un lien existe entre cette personne, affectée à la Terre ou biodiversité, et la chose de la Terre ou biodiversité.
Au final, l’obligation réelle environnementale paraît à l’origine de relations tissées entre le propriétaire foncier et la terre mise au service de la Terre, entre ce fonds servant de la terre et ce grand fonds dominant de la Terre, entre le tiers chargé d’exécuter l’obligation réelle en lieu et place du propriétaire foncier et la terre grevée, enfin, entre ce même tiers et la Terre à laquelle il est affecté. Observons que le propriétaire foncier et son cocontractant font tous deux figure d’obligés vis-à-vis de la chose affectée à la Terre : ledit propriétaire foncier et la personne agissant pour la protection de l’environnement s’entendent au sujet et pour la préservation d’un fonds de terre. Ensemble, ces personnes s’accordent pour veiller sur la chose grevée, non pour l’assujettir et dominer, si bien que cette terre apparaît attributaire d’un droit à l’entretien ou propriétaire d’un droit aux soins.
Aussi, le dispositif pourrait-il relever d’un droit de type analogiste, qui relierait des choses d’ordre micro et macroscopique ; il pourrait ressortir d’un droit réicentré, articulé autour de choses du droit, et qui serait orienté vers la pérennité des fonds ou héritages plutôt que vers leur libre circulation.
